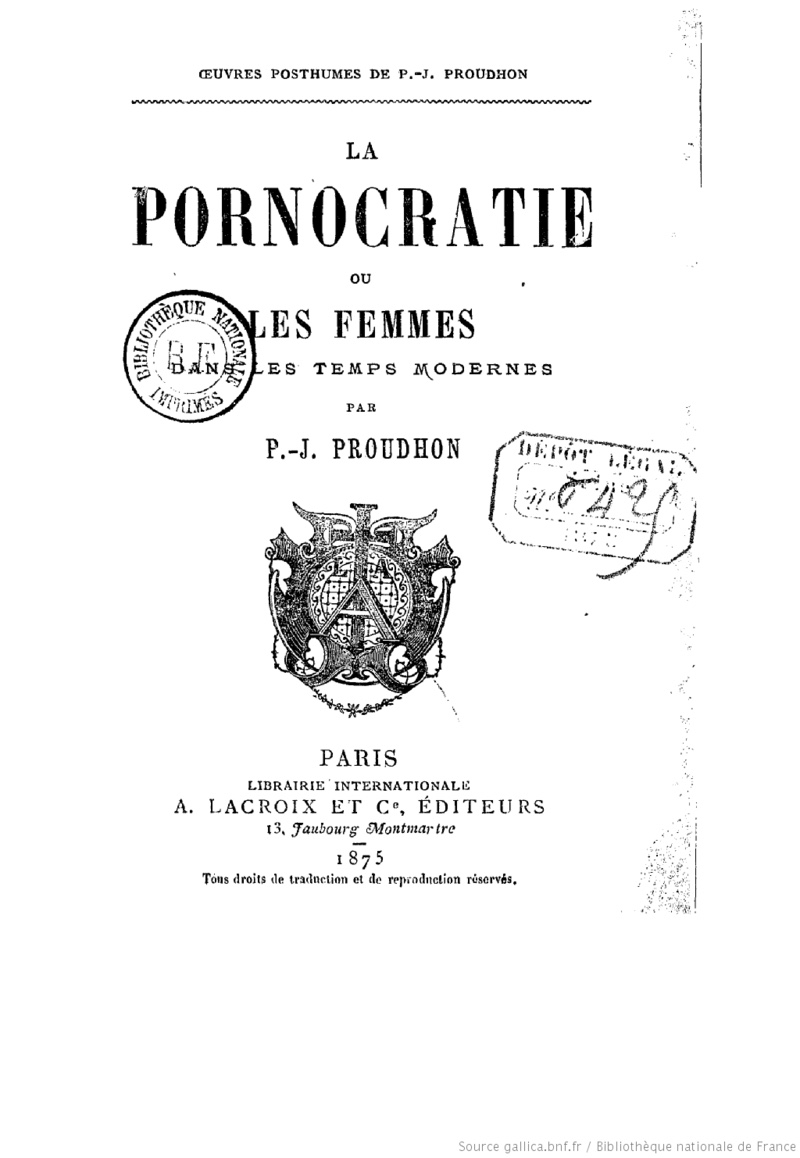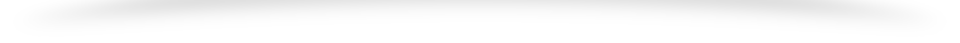Proudhon écrit :
Cette subordination n’a rien du tout d’arbitraire ; ce n’est ni une fiction légale, ni une usurpation de la force, ni une déclaration d’indignité pour le sexe le plus faible, ni une exception commandée par les nécessités de l’ordre domestique et social au droit positif de la femme : elle résulte, cette subordination, de ce fait patent et incontestable, que les attributions viriles embrassent la grande majorité des affaires, tant publiques que domestiques ; elle ne constitue pas, du reste, pour l’homme, au détriment de la femme, la moindre prérogative de bien-être ou d’honneur ; tout au contraire, en lui imposant la charge la plus lourde, elle fait de lui le ministre de la fidélité féminine, de laquelle seule il doit tirer ensuite la sienne.
Changez, modifiez, ou intervertissez, par un moyen quelconque, ce rapport des sexes, vous détruisez le mariage dans son essence ; d’une société en prédominance de justice vous faites une société en prédominance d’amour ; vous retombez dans le concubinat et la papillonne ; vous pouvez avoir encore des pères et des mères, comme vous avez des amants, mais vous n’aurez plus de famille ; et sans famille, votre constitution politique ne sera plus une fédération d’hommes, de familles et de cités libres, ce sera un communisme théocratique ou pornocratique, la pire des tyrannies.
Pour rendre ceci plus sensible, supposons que la nature, qui, d’après moi, par la manière dont elle a doté les deux sexes, a constitué le mariage, et la famille, et la société civile, tels que nous les voyons, ou que du moins il nous est facile d’en déterminer les types, supposons, dis-je, que cette même nature ait voulu établir la société humaine sur un autre mode.
Qu’avait-elle à faire?
Le plan qu’elle a suivi nous indique celui qu’elle a rejeté : c’était de répartir également toutes les facultés entre les sexes, de leur donner à tous deux puissance égale et beauté égale ; de rendre la femme vigoureuse, productrice, guerrière, philosophe, juge, comme l’homme; l’homme, joli, gentil, mignon, agréable, angélique et tout ce qui s’ensuit, comme la femme ; en un mot, de ne laisser subsister de différence entre eux que celle de l’appareil génital, dont il paraît que personne ne se plaint, et sans lequel, quoi que disent les mystiques, on ne conçoit pas l’amour.
Dans ces conditions, il est clair que l’homme et la femme, ayant chacun la plénitude d’attributions que nous ne trouvons aujourd’hui que dans le couple, égaux en tout l’un à l’autre et similaires, moins ce que je n’ai pas besoin de dire, seraient dans des relations tout autres que celles que suppose actuellement le mariage.
L’homme ne serait pas dévoué à la beauté qu’il posséderait ; la femme ne se dévouerait pas davantage à la force, qui lui aurait été également dévolue en partage.
L’influence qu’ils exercent, dans l’état présent de leur constitution l’un sur l’autre, ne serait plus la même : il n’y aurait entre eux ni admiration, ni culte, aucune inclination dévotieuse; nul besoin d’approbation, de confidence, ou d’encouragement, pas plus que de protection, de service ou d’appui.
Les choses redeviendraient entre l’homme et la femme ce que nous les voyons entre personnes de même sexe : service pour service, produit pour produit, idée pour idée. Sans doute il y aura de l’amour, puisque nous conservons, dans ce but exprès, la distinction sexuelle.
Mais ils seront affectés d’une autre manière : leur amour n’ira pas au delà de l’excitation voluptueuse ; il n’aura rien de commun avec la conscience qu’il primera ; n’étant pas transformé par le dévouement le plus absolu, il ne tendra pas à la monogamie et à l’indissolubilité. Il se tiendra dans la zone de la liberté et du concubinat, n’éveillant aucune jalousie, excluant toute idée d’infidélité, s’exaltant au contraire par l’émulation des bonnes fortunes ; en sorte que la tendance générale sera vers une communauté plus ou moins accusée d’amours, d’enfants, de ménages, dans une famille unique qui sera l’État.
Cette organisation, en dehors de la monogamie et de la famille, a été rêvée par tous ceux qui, comme nos émancipées et nos émancipateurs modernes, ont cru à l’égalité de puissance et de beauté dans les deux sexes ; les mystiques l’ont placée dans le ciel, où, disent-ils, il n’y aura plus ni mâles ni femelles ; de nos jours , elle semble à une foule de personnes, même fort instruites, l’unique moyen de détruire l’antagonisme, et par suite d’éteindre le crime et la misère. Mais une pareille société subsisterait-elle ? J’ose affirmer qu’elle serait cent fois pire que la nôtre; pour mieux dire, je la soutiens radicale- ment impossible.
La société subsiste par la subordination de toutes les forces et facultés humaines, individuelles et collectives, à la justice.
Dans le système que je viens d’esquisser, l’individu, ayant en soi la plénitude d’attributions que la nature, ainsi que nous avons pu nous en convaincre, n’a accordée qu’au couple, serait inabordable dans sa personnalité; l’élément idéaliste deviendrait en lui prédominant; la conscience serait subalsubalternisée ; la justice réduite à une idée pure ; l’amour, synonyme de volupté, une simple jouissance. Alors éclaterait, avec une violence indomptable, la contradiction entre l’individu et la société : ce même sujet, qu’on se flattait d’enchaîner à l’ordre public par la communauté d’amours, de femmes, d’enfants, de familles, de ménages, répugnerait d’autant plus au communisme social qu’on l’aurait plus complètement affranchi. Il est possible que l’on ne se battît pas pour les femmes, puisque, d’après l’hypothèse, et eu égard à la constitution physique et morale de l’individu, il n’y aurait pas de jalousie; mais la compétition serait d’autant plus ardente pour le butin, la richesse, le confort et le luxe, toutes choses dont la production resterait soumise aux mêmes lois, et, dans une société livrée à l’amour et à l’idéal, serait encore plus insuffisante qu’aujourd’hui. Établissez, avec la communauté des amours, l’universalité du célibat, et, je ne crains pas de le dire, vous aurez un surcroît de consommation, moins de travail, moins d’épargne, partant plus de misère ; en dernière analyse, à la place d’une société policée, une société vouée au brigandage ou, sinon, à la plus dégradante servitude.
Ce résultat, pour tout homme qui a réréfléchi sur les rapports de la famille, du mariage, du travail, de la production et de l’accumulation de la richesse, ainsi que sur les conditions de la justice dans la Société, est aussi certain que deux et deux font quatre.
Ainsi se confirme, par le développement de l’idée contraire, la théorie du mariage. La société, c’est-à-dire l’union des forces, repose sur la justice. La justice a pour condition organique un dualisme, hors duquel elle se réduit bientôt à une notion pure, inefficace. Ce dualisme, c’est le mariage, formé par l’union de deux personnes complémentaires l’une de l’autre, et dont l’essence est le dévouement, le préparateur l’amour.