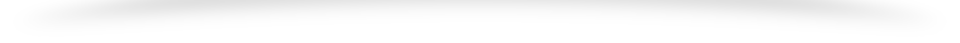Donné à Rome, à Saint-Pierre, le 10 mars de l’année 1791
PIE VI, PAPE
A ses chers Fils, et à ses Vénérables Frères, salut et Bénédiction Apostolique.
L’importance du sujet et les affaires pressantes dont Nous étions accablé, Nous ont forcé, nos chers Fils et nos Vénérables Frères, de différer quelque temps notre réponse à votre lettre du 10 octobre, signée d’un grand nombre de vos illustres collègues. Cette lettre a renouvelé dans notre cœur une douleur profonde, qu’aucune consolation ne pourra jamais adoucir, et dont Nous étions déjà pénétré depuis le moment où la renommée Nous avait appris que l’Assemblée nationale de France, appelée pour régler les affaires civiles, en était venue au point d’attaquer par ses décrets la religion catholique, et que la majorité de ses membres réunissait ses efforts pour faire une irruption jusque dans le sanctuaire.
Nous avions d’abord résolu de garder le silence, dans la crainte d’irriter encore par la voix de la vérité ces hommes inconsidérés, et de les précipiter dans de plus grands excès. Notre dessein était appuyé sur l’autorité de S. Grégoire le Grand, qui dit, qu’il faut peser avec prudence les circonstances critiques des révolutions, pour ne pas laisser la langue se répandre en discours superflus, dans les occasions où il faut la réprimer (Regul. Pastor. Tom. II oper. edit. Maurin., pag. 54.) . C’est à Dieu que nos paroles se sont adressées, et Nous avons aussitôt ordonné des prières publiques, pour obtenir de l’Esprit-Saint qu’il daignât inspirer à ces nouveaux législateurs la ferme résolution de s’éloigner des maximes de la philosophie du siècle, et de s’attacher invariablement à ces principes salutaires auxquels la religion les rappelle. En cela Nous avons suivi l’exemple de Suzanne, qui, selon l’observation de S. Ambroise, fit plus par son silence, qu’elle n’eût pu faire par ses paroles ; elle se taisait devant les hommes, mais elle parlait à Dieu : lors même qu’on n’entendait pas sa voix, sa conscience était éloquente, elle ne cherchait pas le jugement et l’opinion des hommes, parce qu’elle avait pour elle le témoignage de Dieu (Lib. I de Offic., cap. III, num. 9, tom. II oper. edit. Maurin., pag. 4).
Nous n’avons cependant pas négligé d’assembler en Consistoire nos Vénérables Frères les Cardinaux de la sainte Église Romaine, et les ayant convoqués le 29 mars de l’année dernière, Nous leur avons fait part des atteintes que la religion catholique avait déjà reçues en France ; Nous avons épanché notre douleur dans leur sein, les exhortant à unir leurs larmes et leurs prières avec les nôtres.
Tandis que Nous Nous livrions à ces soins, une nouvelle encore plus désolante est venue Nous frapper ; Nous apprenons que l’Assemblée nationale, c’est-à-dire la majorité (c’est toujours dans ce sens que Nous Nous servirons de cette expression) Nous apprenons que l’Assemblée nationale, vers le milieu du mois de juillet, avait publié un décret qui, sous prétexte de n’établir qu’une constitution civile du clergé, ainsi que le titre semblait l’annoncer, renversait en effet les dogmes les plus sacrés, et la discipline la plus solennelle de l’Église, détruisait les droits du premier Siège Apostolique, ceux des Évêques, des Prêtres, des ordres religieux des deux sexes, et de toute la communion catholique, abolissait les cérémonies les plus saintes, s’emparait des domaines et des revenus ecclésiastiques, et entraînait de telles calamités, qu’on aurait peine à les croire si on ne les éprouvait. Nous n’avons pu Nous empêcher de frémir à la lecture de ce décret ; il a produit sur Nous la même impression que fit autrefois sur un de nos plus illustres Prédécesseurs, Grégoire le Grand, un certain écrit qu’un Évêque de Constantinople lui avait envoyé pour le soumettre à son examen : car à peine en eut-il parcouru les premières pages, qu’il fit éclater l’horreur que lui inspirait le venin renfermé dans cet ouvrage (Epist. 66, lib. VI, tom. II, pag. 242). Au plus fort de notre douleur, vers la fin du mois d’août, Nous avons reçu une lettre de notre très-cher Fils en Jésus-Christ Louis XVI, roi très-chrétien, dans laquelle il Nous presse, avec beaucoup d’instances, de confirmer par notre autorité, du moins provisoirement, cinq articles décrétés par l’Assemblée, et déjà revêtus de la sanction royale. Quoique ces articles Nous parussent contraires aux canons, cependant, par égard pour le roi, Nous crûmes devoir user de ménagement dans notre réponse ; Nous lui écrivîmes que Nous soumettrions ces articles à une congrégation de vingt Cardinaux, dont Nous Nous ferions remettre les opinions par écrit, pour les examiner Nous-même à loisir, et les peser avec toute la maturité qu’exige une affaire aussi grave. Dans une autre lettre plus particulière, Nous priâmes le roi lui-même d’engager tous les Évêques de son royaume à lui faire connaître leurs sentiments avec confiance, à Nous communiquer à Nous-même le parti qu’ils seraient convenus de prendre, et à Nous instruire de tout ce que la distance des lieux dérobait à notre connaissance, pour que Nous n’eussions aucune fausse démarche à Nous reprocher. Nous n’avons cependant reçu jusqu’ici de votre part aucun renseignement sur la conduite que Nous avons à tenir dans cette occasion ; seulement des lettres pastorales, des discours, des mandements imprimés de quelques Évêques, Nous sont tombés entre les mains : Nous les avons trouvés pleins de l’esprit évangélique ; mais ces écrits, composés séparément et sans concert, par chacun de leurs auteurs, ne Nous offraient point un plan général de défense ; ils ne Nous indiquaient point les mesures que vous jugiez les plus convenables dans une circonstance aussi fâcheuse, et dans l’extrémité où vous vous trouvez.
Il Nous est cependant parvenu une exposition manuscrite de vos sentiments sur la constitution du clergé, que Nous avons ensuite reçue imprimée, dont le préambule présente un extrait de plusieurs décrets de l’Assemblée, accompagnés de réflexions qui en font connaître l’irrégularité et le venin. Presque dans le même temps, on Nous a remis une nouvelle lettre du roi, par laquelle il Nous demande notre approbation provisoire pour sept autres décrets de l’Assemblée nationale, à peu près conformes aux cinq qu’il Nous avait envoyés au mois d’août ; il Nous fait part aussi du cruel embarras où le jette la sanction qu’on le presse de donner au décret du 27 novembre, décret qui ordonne aux Évêques, à leurs Vicaires, aux Curés, Supérieurs de séminaires, et autres fonctionnaires ecclésiastiques, de prêter, en présence des municipalités, le serment de maintenir la constitution, et, s’ils n’obéissent au terme prescrit, leur inflige les peines les plus graves. Mais Nous avons répété et confirmé ce que Nous avons déjà déclaré, et ce que Nous déclarons encore, que Nous ne publierions point notre jugement sur ces articles, avant que la majorité des Évêques ne Nous eût clairement et distinctement exposé ce qu’elle en pense elle-même.
Le roi nous demande, entre autres choses, d’engager les Métropolitains et les Évêques à souscrire à la division et à la suppression des Églises métropolitaines et des évêchés ; il Nous prie de consentir, du moins provisoirement, à ce que les formes canoniques observées jusqu’ici par l’Église, dans les érections de nouveaux évêchés, soient employées maintenant par l’autorité des Métropolitains et des Évêques ; qu’ils donnent l’institution à ceux qui, d’après le nouveau mode d’élection, leur seront présentés pour les cures vacantes, pourvu que les mœurs et la doctrine des élus soient sans reproche. Cette demande du roi prouve clairement qu’il reconnaît lui-même la nécessité de consulter les Évêques dans une pareille circonstance, et qu’en conséquence il est juste que Nous ne décidions rien avant de les avoir entendus. Nous attendons donc un exposé fidèle de vos avis, de vos sentiments, de vos résolutions, signé de tous, ou du plus grand nombre. Nos idées s’appuieront sur ce monument comme sur une base solide ; il sera le guide et la règle de nos délibérations ; il Nous aidera à prononcer un jugement convenable, également avantageux pour vous et pour tout le royaume de France. En attendant que notre vœu s’accomplisse, Nous trouvons dans vos lettres des secours qui Nous facilitent l’examen de tous les articles concernant la constitution du clergé.
D’abord, en jetant les yeux sur les actes du Concile de Sens, assemblé en 1527 pour combattre l’hérésie du Luther, Nous trouvons que le principe sur lequel cette constitution est fondée, ne peut être exempt de la note d’hérésie ; car c’est ainsi que s’exprime le Concile (In collect. Labbe, tom. XIX, pag. 1154, edit. Venet. Coleti, qua semper utemur) :
» A la suite de ces hommes ignorants, s’est élevé Marsile de Padoue, dont le livre empoisonné, intitulé le Boulevard de la Paix, a été dernièrement imprimé par les soins des Luthériens, pour le malheur du peuple fidèle. L’auteur y insulte l’Église avec l’acharnement d’un ennemi ; il flatte avec impiété les princes de la terre, enlève aux Prélats toute juridiction extérieure, excepté celle que le magistrat laïque aura bien voulu leur accorder. Il prétend, outre cela, que tous ceux qui sont revêtus du sacerdoce, tant les simples Prêtres que les Évêques, les Archevêques, et même le Pape, ont, en vertu de l’institution de Jésus-Christ, une égale autorité, et que si quelqu’un a plus de puissance qu’un autre, c’est une pure concession du prince, qu’il peut révoquer à son gré. Mais l’abominable fureur de cet hérétique en délire a été réprimée par les saintes Écritures, qui déclarent que la puissance ecclésiastique est indépendante de la puissance civile, qu’elle est fondée sur le droit divin, qui l’autorise à établir des lois, pour le salut des fidèles, et à punir les rebelles par des censures légitimes. Les mêmes Écritures enseignent que la puissance de l’Église est, par la fin qu’elle se propose, d’un ordre supérieur à celui de la puissance temporelle, et en cela plus digne de nos respects ; tandis que ce Marsile, et les autres hérétiques nommés ci-dessus, se déchaînent avec impiété contre l’Église, et s’efforcent, comme à l’envi l’un de l’autre de lui ravir quelque partie de son autorité. »
Il faut encore vous rappeler ici un jugement de Benoît XIV, d’heureuse mémoire, absolument conforme à cette doctrine du Concile. Ce Pontife, écrivant au Primat, aux Archevêques et Évêques de Pologne, s’exprime ainsi dans sa Lettre du 5 mars 1752, sur un ouvrage imprimé en polonais mais publié auparavant en français sous ce titre : » Principes sur l’essence, la distinction et les limites des deux puissances, spirituelle et temporelle, ouvrage posthume du P. Laborde, de l’Oratoire, » dans lequel l’auteur soumet le ministère ecclésiastique à l’autorité temporelle, au point de soutenir que c’est à celle-ci qu’il appartient de connaître et de juger du gouvernement extérieur et sensible de l’Église : » Cet impudent écrivain, dit Benoît XIV, accumule d’artificieux sophismes, emploie, avec une perfidie hypocrite, le langage de la piété et de la religion ; donne la torture à plusieurs passages de l’Écriture sainte et des Pères, pour reproduire et ressusciter un système faux et dangereux, depuis longtemps réprouvé par l’Église, expressément condamné comme hérétique, et par cette ruse il en impose aux lecteurs simples et crédules. » En conséquence, ce Pontife proscrivit l’ouvrage comme captieux, faux, impie et hérétique ; il en défendit la lecture et l’usage à tous les fidèles chrétiens, même à ceux qui, par le droit, doivent être spécialement et individuellement dénommés, sous peine d’excommunication encourue par le seul fait, et dont l’absolution serait réservée au Souverain Pontife excepté à l’article de la mort (Bullar. Benedict. XIV, tom. IV, Constitut. 44, edit. Rom.).
En effet, quelle juridiction les laïques peuvent-ils avoir sur les choses spirituelles ? De quel droit les ecclésiastiques seraient-ils soumis à leurs décrets ? Il n’y a point de Catholique qui puisse ignorer que Jésus-Christ, en instituant son Église, a donné aux Apôtres et à leurs successeurs une puissance indépendante de toute autre, que tous les Pères de l’Église ont unanimement reconnue avec Ozius et S. Athanase, lorsqu’ils disaient (S. Athanas. in Histor. Arianor. ad Monachos, tom. I oper., pag. 371, edit. Maurin.) : » Ne vous mêlez point des affaires ecclésiastiques ; ce n’est pas à vous à nous donner des préceptes sur cet article : vous devez au contraire recevoir de nous des leçons. Dieu vous a confié l’empire, mais il a remis le gouvernement de l’Église entre nos mains ; de même que celui qui voudrait vous ravir l’empire renverserait l’ordre que Dieu a établi ; de même craignez qu’en attirant à vous l’autorité spirituelle, vous ne vous rendiez encore plus coupable. » Voilà pourquoi S. Chrysostome, voulant mettre cette vérité dans un plus grand jour, cite l’exemple d’Oza (Commentar. in cap. I Epist. ad Galat. Num. 6, tom. I, oper. edit. Maurin., pag. 668), qui » fut frappé de mort pour avoir porte la main à l’arche, quoique avec l’intention de s’opposer à sa chute, parce qu’il avait usurpé un pouvoir qui ne lui appartenait pas. Mais si la violation du sabbat, si le seul attouchement de l’arche prête à tomber, ont pu exciter la colère de Dieu, et rendre le coupable indigne de pardon, quelle excuse peut avoir, quelle indulgence peut espérer celui qui ose altérer les dogmes augustes et ineffables de notre foi ? Comment pourrait-il se soustraire au châtiment ? Non, vous dis-je ; non, cela n’est pas possible. » Les saints Conciles tiennent tous le même langage ; et tous les monarques français ont reconnu et adopté cette doctrine jusqu’à Louis XV, aïeul du roi régnant, lequel déclarait solennellement, le 10 août 1731, qu’il reconnaissait » comme son premier devoir d’empêcher qu’à l’occasion des disputes, on ne mette en question les droits sacrés d’une puissance qui a reçu de Dieu seul le droit de décider les questions de doctrine sur la foi, ou sur la règle des mœurs, de faire des canons ou des règles de discipline pour la conduite des ministres de l’Église et des fidèles dans l’ordre de la religion, d’établir ses ministres ou de les destituer conformément aux mêmes règles et de se faire obéir en imposant aux fidèles, suivant l’ordre canonique, non-seulement des pénitences salutaires, mais de véritables peines spirituelles, par les jugements ou par les censures que les premiers Pasteurs ont droit de prononcer. »
Et cependant, malgré des principes si généralement reconnus dans l’Église, l’Assemblée nationale s’est attribué la puissance spirituelle, lorsqu’elle a fait tant de nouveaux règlements contraires au dogme et à la discipline ; lorsqu’elle a voulu obliger les Évêques et tous les Ecclésiastiques à s’engager par serment à l’exécution de ces décrets. Mais cette conduite n’étonnera pas ceux qui observeront que l’effet nécessaire de la constitution décrétée par l’Assemblée est d’anéantir la Religion catholique, et avec elle l’obéissance due aux rois. C’est dans cette vue qu’on établit, comme un droit de l’homme en société, cette liberté absolue, qui non-seulement assure le droit de n’être point inquiété sur ses opinions religieuses, mais qui accorde encore cette licence de penser, de dire, d’écrire et même de faire imprimer impunément en matière de religion tout ce que peut suggérer l’imagination la plus déréglée : droit monstrueux, qui paraît cependant à l’Assemblée résulter de l’égalité et de la liberté naturelles à tous les hommes. Mais que pouvait-il y avoir de plus insensé, que d’établir parmi les hommes cette égalité et cette liberté effrénée qui étouffe complètement la raison, le don le plus précieux que la nature ait fait à l’homme, et le seul qui le distingue des animaux. Dieu, après avoir créé l’homme, après l’avoir établi dans un lieu de délices, ne le menaça-t-il pas de la mort s’il mangeait du fruit de l’arbre de la science du bien et du mal ? Et par cette première défense ne mit-il pas des bornes à sa liberté ? Lorsque dans la suite sa désobéissance l’eut rendu coupable, ne lui imposa-t-il pas de nouvelles obligations par l’organe de Moïse ? et quoiqu’il eût laissé à son libre arbitre le pouvoir de se déterminer pour le bien ou pour le mal, ne l’environna-t-il pas » de préceptes et de commandements, qui pouvaient le sauver s’il voulait les accomplir ? » (Ecclesiastic. Cap. XV, vers. 15 et 16.)
Où est donc cette liberté de penser et d’agir que l’Assemblée nationale accorde à l’homme social comme un droit imprescriptible de la nature ? Ce droit chimérique n’est-il pas contraire aux droits du Créateur suprême, à qui nous devons l’existence et tout ce que nous possédons ? Peut-on d’ailleurs ignorer que l’homme n’a pas été créé pour lui seul, mais pour être utile à ses semblables ? car telle est la faiblesse de la nature, que les hommes, pour se conserver, ont besoin du secours mutuel les uns des autres ; et voilà pourquoi Dieu leur a donné la raison et l’usage de la parole, pour les mettre en état de réclamer l’assistance d’autrui, et de secourir à leur tour ceux qui imploreraient leur appui. C’est donc la nature elle-même qui a rapproché les hommes et les a réunis en société : en outre, puisque l’usage que l’homme doit faire de sa raison consiste essentiellement à reconnaître son souverain Auteur, à l’honorer, à l’admirer, à lui rapporter sa personne et tout son être ; puisque, dès son enfance, il faut qu’il soit soumis à ceux qui ont sur lui la supériorité de l’âge ; qu’il se laisse gouverner et instruire par leurs leçons ; qu’il apprenne d’eux à régler sa vie d’après les lois de la raison, de la société et de la religion : cette égalité, cette liberté si vantées, ne sont donc pour lui, dès le moment de sa naissance, que des chimères et des mots vides de sens. » Soyez soumis par la nécessité, » dit l’apôtre S. Paul (Apost. Epist. ad Roman., cap. XIII, vers. 5) : ainsi les hommes n’ont pu se rassembler et former une association civile, sans établir un gouvernement, sans restreindre cette liberté, et sans l’assujettir aux lois et à l’autorité de leurs chefs. » La société humaine, dit S. Augustin, n’est autre chose qu’une » convention générale d’obéir aux rois ; » (Lib. III Confession., cap. VIII, tom. I, Oper. edit. Maurin., pag. 94) et ce n’est pas tant du contrat social que de Dieu lui-même, auteur de tout bien et de toute justice, que la puissance des rois tire sa force. » Que chaque individu soit soumis aux puissances, dit le grand Apôtre dans la même Épître : car toute puissance vient de Dieu ; celles qui existent ont été réglées par Dieu même : leur résister, c’est troubler l’ordre que Dieu a établi ; et ceux qui se rendent coupables de cette résistance, se dévouent eux-mêmes à des châtiments éternels. » (Apost. Epist. ad Roman., cap. XIII, vers. 1 et 2.)
C’est ici le lieu de rapporter le canon du second Concile de Tours, tenu en 567, qui frappe d’anathème, non-seulement quiconque a la hardiesse de contrevenir aux décrets du Siège Apostolique, mais encore » celui qui, par une plus grande témérité, ose réfuter et combattre de quelque manière que ce soit, une pensée que l’apôtre S. Paul, ce vase d’élection, a publiée d’après l’inspiration de l’Esprit-Saint, surtout, puisque le Saint-Esprit lui-même a dit par l’organe de cet apôtre : » Que celui qui prêchera le contraire de ce que j’ai prêché, soit anathème. » (Canon 20, in collect. Labbe, tom. VI, pag. 54.
Mais pour faire évanouir aux yeux de la saine raison ce fantôme d’une liberté indéfinie, ne suffit-il pas de dire que ce système fut celui des Vaudois et des Beguars, condamnés par Clément V, avec l’approbation du Concile œcuménique de Vienne (Cap. III in Clementin. tit. de hæreticis) : que dans la suite les Vicleffites, et enfin Luther, se servirent du même appât d’une liberté effrénée pour accréditer leurs erreurs, disant : Nous sommes affranchis de toute espèce de joug (Ut refert auctor appendic. ad S. Thomam, prima secundæ, quæstion. 96, art. 5, edit. Neapol. 1763). Nous devons cependant avertir qu’en parlant ici de l’obéissance due aux puissances légitimes, notre intention n’est pas d’attaquer les nouvelles lois civiles auxquelles le roi a pu donner son consentement, comme n’ayant de rapport qu’au gouvernement temporel dont il est chargé. Nous n’avons point pour but, en rappelant ces maximes, de provoquer le rétablissement du régime ancien de la France (*) : le supposer, serait renouveler une calomnie qu’on n’a affecté jusqu’ici de répandre que pour rendre la religion odieuse : nous ne cherchons, vous et moi, nous ne travaillons qu’à préserver de toute atteinte les droits sacrés de l’Église et du Siège Apostolique. C’est dans cette vue que Nous allons envisager ici la liberté sous un autre rapport, et faire sentir la différence qui se trouve entre les peuples étrangers à l’Église, tels que les infidèles et les Juifs, et ceux que la régénération du baptême a soumis à ses lois. Les premiers ne doivent pas être assujettis à l’obéissance prescrite aux Catholiques ; mais, pour les seconds, elle est un devoir. S. Thomas d’Aquin (Secunda secundæ quæst. 10, art. 8.) prouve cette différence avec sa solidité ordinaire. Plusieurs siècles auparavant, elle avait été établie par Tertullien dans son ouvrage contre les Gnostiques (Cap. II, n° 15), et Benoît XIV l’a reconnue il y a quelques années dans son Traité de la béatification et de la canonisation (Lib. III, cap. XVII, n° 13) ; mais personne n’a mieux développé ce raisonnement que S. Augustin, dans deux célèbres épîtres souvent imprimées, l’une à Vincent, évêque de Cartenne (Epist. 93, t. II oper., pag. 237, edit. Maurin.), l’autre au comte Boniface (Epist. 185, tom. eod., pag. 652), où il réfute victorieusement les hérétiques tant anciens que modernes. Cette égalité, cette liberté si exaltées par l’Assemblée nationale, n’aboutissent donc qu’à renverser la religion catholique, et voilà pourquoi elle a refusé de la déclarer dominante dans le royaume, quoique ce titre lui ait toujours appartenu.
(*) : Dans le Bref du 6 juillet 1791, adressé au roi, tom. III, Appendix, pars II, n° 1, le Pape dit : Imploramus tibi receptam a te pristinam potestatem… juraque omnia restituta. Dans celui du 25 février 1792, tom. III, Appendix, pars II, n° 2, il souhaite le rétablissement de la royauté en France, Regnumque illud (Galliæ) ad pristina jura revertatur. Enfin, dans celui du 8 août 1792, tom. III, Appendix, pars II, n° 4, il engage l’empereur d’Allemagne ut in suum referat statum non minus Ecclesiam, quam regnum Galliæ. Il faut concilier ces passages avec celui-ci : Nolumus eo accipi sensu… ut omnia ad pristinum civilem statum redintegrentur. Pour lever la contradiction apparente, il faut entendre que le Pape ne veut point provoquer le rétablissement de l’ancien régime accompagné de ses abus.
En avançant dans l’examen des erreurs de l’Assemblée nationale, Nous rencontrons l’abolition de la primauté et de la juridiction du Saint-Siège. Un décret formel porte que » le nouvel Évêque ne pourra s’adresser au Pape pour en obtenir aucune confirmation, mais il lui écrira comme au chef visible de l’Église universelle, en témoignage de l’unité de foi et de la communion qu’il doit entretenir avec lui. » On prescrit une nouvelle formule de serment, où le nom du Pontife de Rome est supprimé. Bien plus, l’élu étant obligé par son serment à l’exécution des décrets nationaux qui lui défendent de faire confirmer son élection par le Saint-Siège, toute la puissance du Souverain Pontife est par là même anéantie, et c’est ainsi que les ruisseaux sont détournés de la source, les rameaux détachés de l’arbre, les peuples séparés du Vicaire de Jésus-Christ.
Qu’il Nous soit permis d’emprunter ici, pour déplorer les outrages faits à la dignité et à l’autorité pontificale, les mêmes expressions dont se servait autrefois saint Grégoire le Grand, pour se plaindre à l’impératrice Constantine des prétentions nouvelles et de l’orgueil du Patriarche Jean, qui s’attribuait le titre d’Évêque universel, et pour la prier de refuser son assentiment à cette usurpation (Epist. 21, lib. V, pag. 751, tom. II, oper. edit. Maurin.) : » Que votre piété, » disait ce saint Pontife, » ne dédaigne pas dans cette occasion mes prières, et si Grégoire (Nous pourrions dire en Nous appliquant les mêmes paroles, si Pie VI), par la grandeur de ses péchés, a mérité de souffrir cette injure, songez que l’apôtre saint Pierre n’a point de péchés à expier, et qu’il n’a pas mérité de recevoir sous votre gouvernement un pareil outrage. Je vous supplie donc, et je vous conjure d’imiter l’exemple des princes vos ancêtres, qui se sont toujours efforcés de s’attirer la faveur de l’apôtre saint Pierre ; tâchez aussi de vous la procurer, et de la conserver ; mes péchés, et les faiblesses auxquelles je suis indignement asservi, ne doivent pas être pour vous un prétexte de porter quelque atteinte aux honneurs dus à cet illustre Apôtre, qui peut vous aider dans toutes vos entreprises, et dans la suite vous obtenir de Dieu le pardon de toutes vos offenses. »
Les prières que saint Grégoire adressait à l’impératrice pour l’honneur de la dignité pontificale, Nous vous les adressons aujourd’hui ; ne souffrez pas que dans ce vaste empire on avilisse la Primauté qui appartient au Saint-Siège et qu’on anéantisse les droits qui y sont attachés ; considérez les mérites de Pierre, dont je suis l’héritier, quoique indigne, et dont la grandeur doit être honorée jusque dans mon néant et dans ma bassesse. Si une puissance étrangère à l’Église enchaîne votre zèle, que la religion et la fermeté suppléent du moins à la force qui vous manque, et rejetez courageusement le serment qu’on exige de vous. Le titre usurpé par Jean était un moindre attentat aux Prérogatives du Saint-Siège, que le décret de l’Assemblée nationale. Comment, en effet, peut-on dire que l’on conserve, que l’on entretient la communion avec le chef visible de l’Église, lorsqu’on se borne à lui donner avis de son élection, et lorsqu’on s’engage par serment à ne point reconnaître l’autorité attachée à sa primauté ? En sa qualité de chef, tous ses membres ne lui doivent-ils pas la promesse solennelle de l’obéissance canonique, seule capable de conserver l’unité dans l’Église, et d’empêcher que ce corps mystique établi par Jésus-Christ ne soit déchiré par des schismes ? Voyez, dans les Antiquités ecclésiastiques de Martenne (Tom. II, lib I, cap. II, art. 11, ord. I°, et apud Sirmond. in appendic. ad tom. II Concilior. Galliæ, de antiquis Episcop. promotion. formul. 13, pag. 656), la formule de serment en usage pour les Églises de France depuis un grand nombre de siècles : tous les Évêques, dans la cérémonie de leur ordination, avaient coutume d’ajouter à leur profession de foi la clause expresse de l’obéissance au Pontife de Rome.
Nous n’ignorons pas sans doute, et ne croyons pas devoir dissimuler ce que les partisans de la constitution du clergé opposent à cette doctrine, et les objections qu’ils tirent de la lettre de saint Hormisdas à Epiphane, Patriarche de Constantinople, ou plutôt l’abus qu’ils font de cette lettre, qui dépose contre eux. On y trouve en effet la preuve de l’usage où étaient les Évêques élus d’envoyer des députés avec une lettre et leur profession de foi au Pontife Romain, pour lui demander d’être admis à la communion du Saint-Siège, et obtenir ainsi l’approbation de leur élection. Epiphane ayant négligé l’observation de ces formalités, saint Hormisdas lui écrivit en ces termes : » J’ai été fort surpris de votre négligence à observer l’ancien usage, maintenant surtout que par la grâce de Dieu l’union est rétablie dans les Églises ; comment avez-vous pu vous dispenser de ce devoir de paix et de fraternité, que l’orgueil n’exige pas, mais que la règle prescrit ? Il convenait, mon très-cher Frère, qu’au commencement de votre pontificat vous eussiez l’attention d’envoyer des députés au Siège Apostolique pour me donner l’occasion de vous faire connaître toute mon affection, et pour vous conformer à l’ancienne et respectable coutume établie dans l’Église. » (Epist. 71, in collect. Concil. Labbe, t. I, p.665)
Les adversaires de la Primauté concluent de ce mot, » il convenait, » que cette députation n’était qu’une simple politesse, une cérémonie de surérogation : mais le style de toute la lettre, ces expressions » vous dispenser d’un devoir que la règle prescrit, vous conformer à l’ancienne coutume, » prouvent assez que c’est par modération que le Pontife s’est servi de ce terme » il convenait, » et qu’il n’a pas voulu faire entendre que les Évêques ne fussent pas rigoureusement obligés de demander au Pape son approbation.
Mais ce qui achève de fixer le véritable sens de la lettre d’Hormisdas, c’est une autre lettre de saint Léon IX, en réponse à celle que Pierre, Évêque d’Antioche, lui avait écrite, pour lui faire part de son élection (Epist. 5, in collect. Labbe, tom. II, p. 1334) : » En m’annonçant votre élection, vous vous êtes acquitté d’un devoir indispensable, et vous n’avez pas différé de remplir une formalité essentielle pour vous et pour l’Église confiée à vos soins. Élevé, malgré mon indignité, sur le Trône apostolique pour approuver ce qui mérite de l’être, et pour condamner ce qui est blâmable, j’approuve, je loue et confirme avec plaisir la promotion de votre très-sainte fraternité à l’épiscopat, et je prie instamment Notre-Seigneur qu’il vous accorde la grâce de mériter un jour à ses yeux le titre que vous donne déjà le langage des hommes. » Cette lettre ne nous offre pas les conjectures d’un docteur particulier, mais la décision d’un Pontife célèbre par sa sainteté et par ses lumières ; elle ne laisse aucun doute sur le sens que j’ai donné à la lettre d’Hormisdas, et doit être regardée comme le monument le plus authentique du droit qu’a le Pontife Romain de confirmer l’élection des Évêques ; ce droit est encore appuyé sur l’autorité du Concile de Trente (Sess. 23, can. 7, sess. 24, de reformat., cap. I). Nous-même Nous avons entrepris de le soutenir dans notre réponse sur les nonciatures (Cap. VIII, sess. 3, §55 et 56, pag. 211), et plusieurs d’entre vous l’ont défendu par d’illustres et savants écrits (*).
(*) : Depuis l’envoi de ce Bref, Nous sommes tombé sur une lettre du saint Pape Pie V, par laquelle il persiste à refuser la confirmation de Frédéric de Veda, nommé à l’archevêché de Cologne, et cela, parce qu’il ne voulait pas faire une profession de foi dans les termes de la formule approuvée par Pie IV, formule qui veut que l’on reconnaisse que l’Église Romaine est la mère, la maîtresse de toutes les Églises, que l’on promette avec serment une vraie obéissance au Pontife Romain, comme successeur de S. Pierre, prince des apôtres, Vicaire de Jésus-Christ. Et quoique Frédéric, depuis son élection, eût protesté de sa soumission à la foi orthodoxe, s’engageant à verser jusqu’à son sang, s’il le fallait, pour la foi catholique romaine, le saint Pape voyant ses exhortations, ses avis inutiles, ne laissa pas plus longtemps impunie la résistance de Frédéric, et lui enjoignit, ou d’obéir, ou de se démettre. Dans cette alternative, Frédéric aima mieux renoncer au siège de Cologne, que de prêter le serment dans la forme exigée, et il obtint de l’indulgence du Pape, de paraître avoir fait une cession volontaire de l’épiscopat, plutôt que d’en être déchu par sentence. Voyez les témoignages rapportés par Laderchius, Annal. Ecclés., t. XXIII, à l’an 1566, du n° 55 à 59, et à l’an 1567, n° 24.
Nous avons fait cette addition, à l’exemple de saint Léon dans son Épître dogmatique à Flavien, Évêque de Constantinople : et Nous avons cru devoir vous la communiquer, au cas où vous seriez animé du même désir que témoignaient à ce saint Pape les évêques des Gaules, Cérétius, Salonius et Véran, lorsqu’ils lui écrivaient : » Si de nouvelles recherches vous offrent quelque supplément à joindre pour l’édification de tous les lecteurs, ordonnez avec le zèle ordinaire à votre piété qu’on l’ajoute à ce rescrit. » (Dans la collect. des Épitr. Décrét. de S. Léon par Rainaud. Ed. de Paris, 1761, p. 177.)
Mais, disent les apologistes des décrets de l’Assemblée, la constitution du clergé ne regarde que la discipline, qui souvent a changé suivant les circonstances, et qui est encore aujourd’hui susceptible de changement. Je réponds d’abord que, parmi les décrets relatifs à la discipline, on en a glissé plusieurs destructifs du dogme et des principes immuables de la foi, comme Nous l’avons déjà démontré ; mais pour ne parler ici que de la discipline, est-il un catholique qui ose soutenir que la discipline ecclésiastique peut être changée par des laïques ? Pierre de Marca (De Concord. sacerdot. et imper., lib. II, c. VII, num. 8) ne convient-il pas lui-même que les canons des Conciles, et les décrets des Pontifes Romains, ont presque toujours réglé ce qui concerne les rites, les cérémonies, les sacrements, l’examen, les conditions et la discipline du Clergé, parce que ce sujet est de leur compétence, et subordonne à leur juridiction ? à peine pourrait-on citer une ordonnance des souverains, en pareille matière, qui soit émanée de la seule puissance temporelle ; nous voyons que, dans cette partie, les lois civiles ont suivi et jamais précédé.
En 1560, lorsque la faculté de théologie de Paris examina plusieurs assertions de François Grimaudet, avocat du roi, présentées aux États assemblés à Angers, parmi les propositions qu’elle crut devoir censurer on remarque la suivante, qui est sous le n° 6 : Le second point de la religion est en la police et discipline sacerdotale, sur laquelle les rois et princes chrétiens ont puissance d’icelle dresser, mettre en ordre et réformer icelle corrompue. Cette proposition, dit la Faculté, est fausse, schismatique, tendant à énerver la puissance spirituelle ; elle est hérétique, et aucune des preuves dont on l’appuie ne sont concluantes (Carol. d’Argentré, Collect. judicior., tom. II, oper. Paris. 1728, pag. 291, in fin.). C’est d’ailleurs une vérité constante que la discipline ne peut être changée témérairement et arbitrairement, puisque les deux plus brillantes lumières de l’Église, S. Augustin (Epist. 54 ad Jan., cap. V, tom. II, oper. edit. Maurin, pag. 126) et S. Thomas d’Aquin (Prima secundæ quest. 97, art. 2), enseignent positivement que les points de discipline ne peuvent être changés sans nécessité, ou une grande utilité, parce que l’avantage de la réforme est souvent détruit par les inconvénients de la nouveauté, parce qu’on » ne doit changer aucun article de la discipline, dit S. Thomas, sans rendre d’un côté au bien commun ce qu’on lui ôte de l’autre. » Bien loin qu’on puisse reprocher aux Pontifes Romains d’avoir altéré la discipline, il est vrai de dire qu’ils ont toujours employé l’autorité que Dieu leur a confiée, à l’améliorer et à la perfectionner pour l’édification de l’Église. Nous voyons avec douleur que l’Assemblée nationale a fait tout le contraire, comme il est aisé de s’en convaincre en comparant chacun de ses décrets avec la discipline ecclésiastique.
Mais avant d’en venir à l’examen de ces articles, il est bon d’observer d’abord la liaison intime que la discipline a souvent avec le dogme, combien elle contribue à conserver sa pureté ; n’oublions pas aussi que les changements bien rares permis par l’indulgence des Pontifes Romains, ont eu peu d’utilité et une courte durée ; et certes les saints Conciles ont souvent lancé la peine d’excommunication contre ceux qui n’étaient coupables que d’infractions contre la discipline de l’Église. En effet, le Concile tenu en 692 à Constantinople dans le palais de l’empereur, a excommunié ceux qui mangeraient le sang des animaux suffoqués (Can. 67, in Collect. Labbe, tom. VII, pag. 1378) : » Si quelqu’un à l’avenir, dit le Concile, ose se permettre de manger le sang des animaux, s’il est dans les ordres, qu’il soit déposé ; s’il est laïque, qu’il soit séparé de la communion de l’Église. »
Le Concile de Trente, dans beaucoup d’endroits, frappe également d’anathème ceux qui attaquent la discipline ecclésiastique. En effet, dans le neuvième canon de la session 13, qui traite de l’Eucharistie, il dit anathème à » ceux qui nieraient que tous et chacun des fidèles de l’un et l’autre sexe qui ont atteint l’âge de raison, sont obligés de communier au moins une fois l’année dans le temps de Pâques, selon le commandement de la sainte Église notre mère. » Même peine prononcée par le septième canon de la session 22, qui traite du Sacrifice de la Messe, contre ceux qui diraient que » les cérémonies, les ornements, et les signes extérieurs que l’Église catholique emploie dans la célébration de la messe, sont plus propres à exciter les sarcasmes des impies, qu’à nourrir la piété des fidèles. » Même peine infligée par le canon neuvième de la même session contre ceux qui prétendraient » qu’on doit blâmer le rit de l’Église romaine qui oblige les prêtres de réciter à voix basse une partie du Canon de la messe, ainsi que les paroles de la consécration, et que la messe elle-même ne devrait être célébrée qu’en langue vulgaire. » Même peine ordonnée par le canon 4 de la session 24, du Sacrement de Mariage, contre ceux qui » oseraient soutenir que l’Église n’a pas eu le pouvoir d’établir des empêchements dirimants, ou qu’elle s’est trompée en les établissant. » Même peine infligée dans le neuvième canon de la même session contre ceux qui diraient » que les ecclésiastiques engagés dans les ordres sacrés, ou les religieux obligés à la chasteté par la profession solennelle, peuvent se marier, que leur mariage est valide malgré la loi que l’Église a portée pour les premiers, ou les vœux que les derniers ont prononcés ; que soutenir le contraire serait blâmer le mariage lui-même ; enfin qu’il est permis de contracter mariage à tous ceux qui ne croient pas avoir reçu du Ciel le don de chasteté, quand même ils se seraient engagés par un vœu à la pratique de cette vertu. » Même peine portée par le canon onzième de la même session, contre ceux qui diraient » que la défense de célébrer les mariages dans certains temps de l’année, est une superstition et une tyrannie qui prennent leur source dans les superstitions du paganisme, et qui croiraient devoir condamner les bénédictions et les autres cérémonies en usage dans l’Église pour l’administration de ce sacrement. » Même peine enfin prononcée par le douzième canon de la même session, contre ceux qui soutiendraient que les causes relatives aux mariages ne sont pas du ressort des juges ecclésiastiques. »
Alexandre VII a condamné depuis, sous la même peine d’excommunication, la traduction en langue française du Missel romain, comme une nouveauté propre à faire perdre à l’Église une partie de sa beauté, et capable d’introduire, avec l’esprit de désobéissance, de témérité, d’audace, de révolte et de schisme, tous les maux qui peuvent en être la suite. Tant d’exemples d’anathèmes lancés contre les infracteurs de la discipline, prouvent que l’Église a toujours cru qu’elle était étroitement liée avec le dogme, qu’elle ne peut jamais être changée que par la puissance ecclésiastique, à laquelle seule il appartient de juger que l’usage constamment suivi est sans avantage, ou doit céder à la nécessité de procurer un plus grand bien.
Il Nous reste à vous faire voir que ces innovations, dont on espérait tant d’avantages, n’ont été ni utiles ni durables. Rappelez-vous que Pie IV, cédant enfin aux vives instances de l’empereur Ferdinand, et d’Albert, duc de Bavière, accorda à quelques Évêques d’Allemagne le privilège de permettre, à certaines conditions, la communion sous les deux espèces ; mais le saint Pontife Pie V, voyant qu’il en résultait plus de mal que de bien pour l’Église, révoqua cette concession dès le commencement de son Pontificat, par deux Brefs apostoliques, l’un du 8 juin 1566, adressé à Jean, Patriarche d’Aquilée, l’autre daté du lendemain, et envoyé à Charles, archiduc d’Autriche. Urbain, Évêque de Passaw, lui ayant demandé la même grâce, Pie V lui répondit le 26 mai 1568 (Relat. a Laderch. Annal. Ecclesiast. ad. ann. 1568, pag. 60, edit. Rom. 1733), et l’exhorta d’une manière très-pressante » à conserver l’antique et saint usage de l’Église, plutôt que d’adopter la coutume des hérétiques ; vous devez, lui dit-il, persister dans ce sentiment avec un courage et une constance inébranlable : la crainte d’aucune perte, d’aucun danger ne doit vous en détacher, fallût-il faire le sacrifice de vos biens et même de votre vie. Le prix que Dieu réserve à cette fermeté doit vous paraître préférable à tous les biens et à toutes les richesses de la terre : un chrétien, un catholique, loin de fuir le martyre, doit le désirer, le regarder comme un rare bienfait, et il doit envier le sort de celui qui a été trouvé digne de répandre son sang pour Jésus-Christ, et pour ses augustes sacrements. » C’est donc avec raison que saint Léon le Grand, écrivant sur certains points de discipline aux Évêques établis dans la Campanie, dans le Picentin, dans la Toscane et dans diverses provinces, termine ainsi sa lettre (Epist. 3, tom. II, oper. edit. Tyrna., 1767) : » Je vous déclare que si quelqu’un de nos frères entreprend de violer ces règlements, s’il ose pratiquer ce qui est défendu, il sera déchu de son office, et ne participera point à notre communion, puisqu’il n’aura point voulu participer à notre discipline. »
Examinons maintenant les divers articles de la constitution du clergé. Un des plus répréhensibles est sans doute celui qui anéantit les anciennes métropoles, supprime quelques évêchés, en érige de nouveaux et change toute la distribution des diocèses. Notre intention n’est pas de faire ici une dissertation critique sur la description civile des anciennes Gaules, sur laquelle l’histoire a laissé une grande obscurité, pour vous montrer que les métropoles ecclésiastiques n’ont point suivi l’ordre des provinces, ni pour le temps ni pour le lieu ; il suffit au sujet que Nous traitons, de bien établir que la distribution du territoire fixée par le gouvernement civil n’est point la règle de l’étendue et des limites de la juridiction ecclésiastique. Saint Innocent Ier en donne la raison (Epist. 24 ad Alexandrum Antioch., cap. II, apud Coustant., pag. 852) : » Vous me demandez, dit-il, si d’après la division des provinces établie par l’empereur, de même qu’il y a deux métropoles, il faut aussi nommer deux Évêques métropolitains ; mais sachez que l’Église ne doit point souffrir des variations que la nécessité introduit dans le gouvernement temporel, que les honneurs et les départements ecclésiastiques sont indépendants de ceux que l’empereur juge à propos d’établir pour ses intérêts. Il faut par conséquent que le nombre des Évêques métropolitains reste conforme à l’ancienne description des provinces. » Pierre de Marca ajoute un grand poids à cette lettre en la rapprochant de la pratique de l’Église gallicane (De Concord. sacerd. et imper., lib. II, cap. IX, num. 4 et 7) : » Cette Église, dit-il, s’est trouvée d’accord avec le Concile de Chalcédoine, et le décret d’Innocent : elle a pensé que les rois n’avaient pas le droit d’ériger de nouveaux évêchés, etc. Il ne faut pas, par une basse flatterie envers les princes, nous écarter du sentiment général de l’Église universelle, comme il est arrivé à Marc-Antoine de Dominis, qui, faussement et contre les canons, attribue aux rois le pouvoir d’ériger des évêchés. Cette erreur a été embrassée par quelques modernes ; la vérité est qu’à l’Église seule appartient le droit de régler tout ce qui concerne cet article, comme je l’ai déjà dit. »
Ce qu’on vous demande, Nous dit-on, c’est d’approuver cette division des diocèses décrétée par l’Assemblée ; mais ne faut-il pas que Nous examinions mûrement si Nous devons l’approuver ? et le principe vicieux d’après lequel ces divisions et ces suppressions ont été ordonnées, n’est-il pas un grand obstacle au consentement que Nous pourrions leur donner ? Il faut d’ailleurs remarquer qu’il ne s’agit pas ici de quelques changements dans un ou deux diocèses, mais du bouleversement universel de tous les diocèses d’un grand empire ; il s’agit de déplacer une foule d’Églises illustres, de réduire les Archevêques au simple titre d’Évêques, nouveauté expressément condamnée par Innocent III, qui fit à ce sujet les reproches les plus vifs au Patriarche d’Antioche (Epist. 50, pag. 29, num. 1, epistolar. edit. Paris. Baluz. 1682) : » Par cette étrange innovation vous avez, lui dit-il, pour ainsi dire rapetissé la grandeur, abaissé l’élévation ; faire d’un archevêque un simple évêque, c’est en quelque sorte le dégrader. »
Yves de Chartres jugea que cette nouveauté était d’une si grande conséquence, qu’il se crut obligé de s’adresser au Pape Pascal Il, et de lui demander de ne rien changer à la situation des Églises qui subsistaient depuis quatre cents ans (Epist. 238, pag. 103, part. II, oper. edit. Paris, 1647) : » Prenez garde, lui dit-il, que par là vous ne fassiez naître en France le même schisme qui désole l’Allemagne. » Joignez à cela qu’avant de donner les mains à une telle opération, il Nous faudrait consulter les Évêques dont il s’agit d’abolir les droits, pour qu’on ne puisse Nous accuser d’avoir violé envers eux les lois de la justice. S. Innocent Ier exprime avec beaucoup d’énergie l’horreur que lui inspire une pareille conduite (Epist. 7, num. 2, ad clerum et popul. Constantinop., apud Coustant., pag. 798) : » Qui pourrait supporter, dit-il, les malversations dont se rendent coupables ceux mêmes qui étaient spécialement chargés de maintenir la tranquillité, l’union et la paix ? Aujourd’hui, par le plus étrange renversement de l’ordre, nous voyons des prêtres innocents chassés de leurs Églises. Mon frère et mon collègue dans le sacerdoce, Jean, votre Évêque, a été la première victime de cette injustice ; on l’a dépouillé de sa dignité sans vouloir l’entendre ; cependant on ne lui reproche aucun crime, aucun accusateur ne se lève contre lui. Quel est donc ce procédé injuste ? Quoi ! sans aucune forme de procès, sans même un semblant de jugement, on donne des successeurs à des prêtres vivants, comme si des ecclésiastiques qui débutent dans le ministère sous de pareils auspices, et dont le premier pas est un crime, pouvaient jamais être vertueux ou avoir produit des actes de vertu ! Cette violence, absolument sans exemple chez nos ancêtres, était même sévèrement défendue. On ne permit jamais à personne de donner la consécration à un Prêtre nommé à la place d’un Évêque vivant. Une consécration illégitime ne détruit point les droits du premier Évêque ; et celui qu’on lui substitue injustement n’est qu’un intrus inhabile à exercer les fonctions de l’épiscopat. » Enfin, il faudrait auparavant que Nous fussions instruit des sentiments du peuple à qui l’on veut ravir l’avantage d’être plus près de son Pasteur, et plus à portée des secours spirituels.
Ce changement, ou plutôt ce renversement de la discipline, offre une autre nouveauté considérable dans la forme d’élection, substituée à celle qui était établie par un traité mutuel et solennel connu sous le nom de concordat, passé entre Léon X et François Ier, approuvé par le cinquième Concile général de Latran, exécuté avec la plus grande fidélité pendant deux cent cinquante ans, et qui par conséquent, devait être regardé comme une loi de la monarchie. On y avait réglé d’un commun accord la manière de conférer les évêchés, les prélatures, les abbayes et les bénéfices : cependant, au mépris de ce traité, l’Assemblée nationale a décrété que les Évêques à l’avenir seraient élus par le peuple des districts ou des municipalités, et semble avoir voulu par cette disposition embrasser les erreurs de Luther et de Calvin, adoptées depuis par l’apostat de Spalatro ; car ces hérétiques soutenaient que l’élection des Évêques par le peuple était de droit divin. Pour se convaincre de la fausseté de ces opinions, il suffit de se rappeler la forme des anciennes élections. Et pour commencer par Moïse, ce législateur ne conféra-t-il pas la dignité de pontife à Aaron, et ensuite à Éléazar, sans le suffrage et le conseil de la multitude ? Notre-Seigneur Jésus-Christ n’a-t-il pas choisi sans l’intervention du peuple, d’abord douze apôtres, ensuite soixante et dix disciples ?
S. Paul eut-il besoin du peuple pour placer Timothée sur le siège épiscopal d’Éphèse ; Tite sur celui de l’île de Crète ; et Denis l’Aréopagite, qu’il consacra même de ses propres mains, sur celui de Corinthe ? (Euseb. Hist. ecclesiastic. lib. III, cap. IV, n° 15, ibiq. not. 6) S. Jean assembla-t-il le peuple pour créer Polycarpe Évêque de Smyrne ? (S. Hieronymus, de viris illustrib., cap. XVII, t. II, oper. pag. 843, edit. Vallars.) Les apôtres n’ont-ils pas choisi eux-mêmes cette foule innombrable de pasteurs qu’ils envoyaient chez des peuples étrangers et infidèles, pour gouverner les Églises qu’ils avaient fondées dans le Pont, dans la Galatie, dans la Bithynie, dans la Cappadoce et dans l’Asie ? (Euseb. citat., cap. IV, n° 5 ; S. Hieronym. comment. in cap. XXV Matthæi, tom. VII, oper., pag. 207, edit. Vallars.) Le premier Concile de Laodicée (Can. 13) et le quatrième Concile de Constantinople (Œcumenic. VIII, act. 10, canon. 12) reconnaissent la légitimité de ces élections. S. Athanase déclara Frumentius Évêque des Indes dans une assemblée de prêtres et à l’insu du peuple (Rufin., lib. X Histor., cap. IX, sub fin.). S. Basile, sans le concours des citoyens, nomma Euphronius dans un synode, à l’évêché de Nicopolis (Epistol. 193 et 194). Lorsque S. Grégoire II consacra S. Boniface évêque en Allemagne, les Allemands n’en savaient rien, et même ne s’en doutaient pas. L’empereur Valentinien lui-même répondit aux Prélats qui lui déféraient l’élection de l’Évêque de Milan (Theodoret., lib. IV Histor. cap. VII) : » Ce choix est au-dessus de mes forces ; mais vous que Dieu a remplis de sa grâce, qui êtes pénétrés de son esprit, vous choisirez beaucoup mieux que moi. » Si Valentinien pensait ainsi, à plus forte raison, les districts de la France devraient-ils avoir la même modestie, et la conduite de cet empereur devrait être suivie de tous les souverains, législateurs et magistrats catholiques.
À ces autorités, Luther, Calvin et leurs partisans opposent l’exemple de S. Pierre, qui, dans une assemblée des frères, composée de cent vingt personnes, dit : » Il nous faut choisir parmi les disciples qui ont coutume de nous accompagner, quelqu’un qui soit capable de remplir le ministère, et de succéder à l’apostolat dont Judas s’est rendu indigne. » Mais l’objection porte à faux : car, d’abord Pierre ne laissa point à cette foule qui l’environnait la liberté de choisir qui elle jugerait à propos, mais il lui désigna un des disciples. Au reste, S. Chrysostome fait évanouir toute espèce de difficulté en disant (Homil. 3 in Act. Apostol., tom. IX, oper. edit. Maurin., pag. 25, litt. B) : » Quoi ! Pierre ne pouvait-il pas choisir lui-même ? Il le pouvait, sans doute ; mais il s’en abstint, pour que la faveur ne parût pas avoir influé sur son choix. » Cette vérité tire une nouvelle force des autres actions de Pierre, rapportées dans la lettre d’Innocent Ier à Décentius (Epist. 25, apud Coustant., pag. 856, n° 2). Lorsque les Ariens, abusant de la faveur de l’empereur Constance, employèrent la violence pour chasser de leurs sièges les Prélats catholiques, et y placer leurs partisans (ainsi que S. Athanase le rapporte en gémissant (Histor. Arianor. ad monach., n° 4, tom. I, oper. pag. 347, edit. Maurin.)), on fut contraint, par le malheur des temps, d’admettre le peuple à l’élection des Évêques, pour l’exciter à maintenir dans son siège le pasteur qu’on y aurait élevé en sa présence ; mais le clergé ne perdit pas pour cela le droit spécial à l’élection des Évêques, qui lui a toujours appartenu ; et jamais il n’est arrivé, comme on s’efforce aujourd’hui de le faire accroire au public, que le peuple seul ait joui du droit d’élection ; et jamais les Pontifes Romains n’ont abandonné à cet égard l’exercice de leur autorité. Car S. Grégoire le Grand envoya le sous-diacre Jean à Gênes, où il y avait un grand nombre de Milanais assemblés, pour sonder leurs intentions au sujet de Constance, afin que, si elles se fixaient en sa faveur, les Évêques l’élevassent sur le siège de Milan avec l’approbation du Souverain Pontife (Epist. 30, lib. II, pag. 646, edit. Maurin.). Dans une lettre adressée à différents Évêques de la Dalmatie (Epist. 10, lib. IV, pag. 689), le même S. Grégoire, en vertu de l’autorité de S. Pierre, Prince des Apôtres, leur défend d’imposer les mains à qui que ce soit dans la ville de Salone sans son consentement et sa permission, et de donner à cette ville aucun autre Évêque que celui qu’il leur désignerait ; il les menace, s’ils refusent de lui obéir, de les priver de la communion et de ne pas reconnaître pour Évêque celui qu’ils auraient consacré. Il recommande dans une lettre (Epist. 21, tom. VI, pag. 807) à Pierre, Évêque d’Otrante, de parcourir les villes de Brindes, de Lupia et de Gallipoli, dont les Évêques étaient morts, de nommer à leur place des sujets dignes de ce saint ministère, qui se rendraient auprès du Pontife pour recevoir la consécration. Écrivant dans la suite au peuple de Milan (Epist. 4, lib. II, pag. 1094 et seq.), il approuve l’élection qu’on a faite de Dieudonné à la place de Constance ; et s’il n’y a d’ailleurs aucun obstacle de la part des saints canons, il ordonne, en vertu de son autorité, qu’on lui donne solennellement la consécration. S. Nicolas Ier ne cessa de reprocher au roi Lothaire que dans son royaume il n’élevait à l’épiscopat que les hommes qui lui étaient agréables ; il lui enjoint, en vertu de son autorité apostolique, et en le menaçant du jugement de Dieu, de n’établir aucun Évêque à Trèves et à Cologne, avant d’avoir consulté le Saint-Siège (Ivon. Carnot. decret., part. V, cap. 357). Innocent III annula l’élection de l’Évêque de Penna, parce qu’il avait eu la témérité de s’asseoir sur le siège épiscopal avant d’y être appelé ou confirmé par le Pontife Romain (Rainald. ad ann. 1099, n° 19) ; il déclara de même Conrad déchu des évêchés de Hildesheim et de Wirtzbourg, parce qu’il avait pris possession de l’un et de l’autre sans son approbation (Albert. Krantz, metropol., lib. VII, c. XVII, §1). S. Bernard demanda humblement à Honorius II qu’il daignât confirmer la nomination d’Albéric, de Châlons-sur-Marne, élevé à l’épiscopat par son suffrage ; ce qui prouve que le saint abbé était persuadé que les élections d’Évêques étaient de nulle valeur, si elles n’étaient approuvées par le Saint-Siège (Epist. 13, tom. I, oper. p. 33, edit. Maurin.).
Enfin les troubles, les factions, les discordes éternelles, et une foule d’abus forcèrent d’éloigner le peuple des élections, et même de ne plus consulter ni son vœu ni son témoignage. Mais si cette exclusion du peuple a eu lieu lorsque les électeurs étaient tous catholiques, que dire du décret de l’Assemblée nationale qui, excluant le clergé des élections, les livre à des départements dans lesquels il se trouve des juifs, des hérétiques, des hétérodoxes de toute espèce ? La grande influence de ces ennemis de la religion sur le choix des pasteurs produirait cet horrible abus qui excitait l’indignation de saint Grégoire le Grand (Epist. 4, lib. II, pag. 1094 et seq.) : » Non, disait ce Pontife écrivant au peuple de Milan, non, je ne puis consentir en aucune manière à l’élection d’un sujet choisi, non par des catholiques, mais par des Lombards : et si l’on donnait la consécration à un pasteur élu par de tels hommes, on mettrait sur le siège de Milan un bien indigne successeur de S. Ambroise. »
Ce mode d’élection renouvellerait les troubles, réveillerait les haines assoupies depuis si longtemps ; il donnerait même à l’Église catholique des Prélats fauteurs de l’hérésie, des docteurs qui du moins en secret et au fond du cœur nourriraient les opinions erronées des électeurs : » Les jugements du peuple, dit S. Jérôme, sont souvent bien faux, le vulgaire se trompe dans le choix de ses prêtres ; chacun les veut conformes à ses mœurs ; ce n’est pas le meilleur pasteur qu’il cherche, mais un pasteur qui lui ressemble. » (Lib. I advers. Jovin., n° 14, pag. 292, tom. II, oper. edit. Vallars.) Que faudrait-il attendre de ces Évêques qui ne seraient pas entrés par la véritable porte ; ou plutôt que de maux la religion n’aurait-elle pas à craindre de ces hommes qui, enveloppés eux-mêmes dans les filets de l’erreur, seraient incapables d’en garantir le peuple (S. Damas. Epist. 3, n° 2, inter collect. a Coustant., pag. 482 et 486) ? Et certes des pasteurs de cette espèce, quels qu’ils fussent, n’auraient le pouvoir ni de lier ni de délier, puisqu’ils seraient sans mission légitime ; puisqu’ils seraient sur-le-champ solennellement excommuniés par le Saint-Siège, car telle est la peine qu’il a toujours infligée à tous les intrus, et c’est ainsi qu’encore aujourd’hui il a soin de foudroyer, par une proclamation publique, chaque élection des Évêques d’Utrecht (Benedict. XIV, ad univers. cathol. in fœderato Belgio commorantibus, in ejus Bullar., t. I, const. 11).
Mais à mesure qu’on avance dans l’examen de ce décret, on y rencontre des dispositions encore plus vicieuses : les Évêques élus par leurs départements ont ordre d’aller demander la confirmation au Métropolitain, ou au plus ancien Évêque ; s’il la refuse, il est obligé de consigner par écrit les motifs de son refus. L’élu peut en appeler comme d’abus devant les magistrats civils ; ce sont eux qui décideront si l’exclusion est légitime ; ils se constitueront juges des Métropolitains et des Évêques, auxquels cependant appartient de plein droit le pouvoir de juger des mœurs et de la doctrine, et qui, suivant S. Jérôme (Advers. Luciferian, n° 5, tom. II, oper. edit. Vallars, pag. 176), ont été établis pour garantir le peuple de l’erreur. Mais ce qui montre, d’une manière encore plus sensible, l’illégitimité et l’incompétence de cet appel aux laïques, c’est l’exemple mémorable de l’empereur Constantin. Une foule d’Évêques s’étant rendus à Nicée pour y tenir un concile, plusieurs pensaient que l’empereur devait y assister aussi, afin qu’on pût citer à son tribunal les Ariens.
Constantin, après avoir lu les requêtes qui lui furent présentées à ce sujet, fit cette fameuse réponse : » Je ne suis qu’un homme ; ce serait un crime à moi de m’attribuer la connaissance des affaires de cette nature où les accusateurs et les accusés sont honorés du sacerdoce. » (Sozomen. Histor. Eccles., lib. I, cap. XVII, n° 25) Nous pourrions alléguer une multitude de traits semblables ; mais il est inutile d’accumuler les preuves d’une vérité si évidente. Si on oppose au respect de Constantin la conduite de son fils Constance, de cet ennemi déclaré de l’Église catholique, qui s’arrogeait un pouvoir que son père avait avoué ne pas lui appartenir, je citerai le témoignage de S. Athanase (Histor. Arian. ad monach., n° 52, tom. I, oper. edit. Maurin., pag. 376) et de S. Jérôme (Advers. Luciferian, n° 19, tom. II, oper. edit. Vallars, pag. 191), qui s’élèvent contre ces abus sacrilèges de l’autorité.
Enfin, n’est-il pas évident que le but de l’Assemblée dans ces décrets est de renverser et d’anéantir l’épiscopat, comme en haine de la religion dont les ministres sont les Évêques, à qui on impose en outre un conseil permanent de prêtres devant porter le nom de vicaires, et dont le nombre est fixé à seize pour les villes de dix mille habitants, à douze pour les lieux moins peuplés. On force encore les Évêques de s’attacher les Curés des paroisses supprimées ; ils sont déclarés leurs vicaires de plein droit, et, par la force de ce droit, ils sont indépendants de l’Évêque. Quoiqu’on lui laisse le libre choix de ses autres vicaires, il ne peut cependant, sans leur aveu, exercer aucun acte de juridiction, si ce n’est provisoirement ; il ne peut destituer l’un d’eux qu’à la pluralité des suffrages de son conseil. N’est-ce pas vouloir que chaque diocèse soit gouverné par des prêtres, dont l’autorité anéantira la juridiction de l’Évêque. N’est-ce pas contredire ouvertement la doctrine exposée dans les Actes des Apôtres : » Le Saint-Esprit a établi les Évêques pour gouverner l’Église que Dieu a acquise au prix de son sang ? » (Cap. XX, vers. 28) Enfin n’est-ce pas troubler et renverser absolument tout l’ordre de la hiérarchie ? Par là les Prêtres deviennent les égaux des Évêques, erreur que le prêtre Aerius enseigna le premier, et qui fut ensuite soutenue par Wiclef, par Marsile de Padoue, par Jean de Jandune, et enfin par Calvin, comme l’observe Benoît XIV, dans son Traité du Synode diocésain (Lib. XIII, cap. I, n° 2).
Il y a plus : les prêtres sont mis au-dessus des Évêques, puisque les Évêques ne peuvent destituer aucun membre de leur conseil, ni rien décider qu’à la pluralité des suffrages de leurs vicaires ; cependant les chanoines qui composent les chapitres légitimement établis, et qui forment le conseil des Églises, lorsqu’ils sont appelés par l’Évêque, n’ont dans les délibérations que voix consultative, comme Benoît XIV l’affirme d’après deux conciles provinciaux tenus à Bordeaux (Cit. oper. de Synod. eod. lib. XIII, cap. II, n° 6).
Pour ce qui regarde les autres vicaires, qu’on appelle vicaires de plein droit, il est très-étrange, et tout à fait inouï, que les Évêques soient forcés d’accepter leurs services, tandis qu’ils peuvent avoir des motifs très-légitimes pour les rejeter. Il est fort étonnant, surtout, que ces prêtres n’étant que subsidiaires, et remplaçant dans ses fonctions un homme qui n’est pas inhabile à les exercer lui-même, ils ne soient pas soumis à celui au nom duquel ils agissent.
Mais avançons. L’Assemblée a du moins laissé aux Évêques le pouvoir de choisir leurs vicaires dans tout le clergé. Mais quand il a été question de régler l’administration des séminaires, elle a décrété que l’Évêque ne pourrait en choisir les supérieurs que d’après l’avis de ses vicaires, et à la pluralité des suffrages, et ne pourrait les destituer que de la même manière. Qui ne voit à quel point on porte la défiance contre les Évêques, qui cependant sont chargés de droit de l’institution et de la discipline de ceux qui doivent être admis dans le clergé et employés au ministère ecclésiastique ? N’est-il pas incontestable que l’Évêque est le chef et le premier supérieur du séminaire ? Quoique le Concile de Trente (Sess. 23, de reformat., cap. XVIII) ordonne que deux chanoines soient chargés de surveiller l’éducation des jeunes clercs, il laisse cependant aux Évêques la liberté de choisir ces deux chanoines, et de suivre en cela l’inspiration du Saint-Esprit ; il ne les force point à adopter leurs avis et à se conformer à leurs décisions. Quelle confiance les Évêques pourront-ils avoir dans les soins de ceux qui auront été choisis par d’autres, et peut-être par des hommes qui auront juré de maintenir la doctrine empoisonnée que renferment ces décrets ?
Enfin, pour mettre le comble au mépris et à l’abjection où l’on a dessein de plonger les Évêques, on les assujettit tous les trois mois à recevoir, comme vils mercenaires, un salaire modique, avec lequel ils ne pourront plus soulager la misère de cette foule de pauvres qui couvrent le royaume, et bien moins encore soutenir la dignité du caractère épiscopal. Cette nouvelle institution de portion congrue pour les Évêques, contredit toutes les anciennes lois, qui assignaient aux Évêques et aux Curés des fonds de terre pour les administrer eux-mêmes et en recueillir les fruits comme le font les propriétaires. Nous lisons dans les Capitulaires de Charlemagne (Capitular. an. 789, cap. XV, tom. I, pag. 253, edit. Paris., Baluz.) et dans ceux du roi Lothaire (Tit. 4, cap. I, tom. II, pag. 327, ejusd. edit.), qu’il y avait un fonds territorial destiné à chaque Église : » Nous ordonnons, dit un capitulaire, d’après la volonté du roi notre seigneur et père, qu’on donne pour revenu à chaque paroisse un domaine et douze mesures de terres labourables. » Lorsque la dot assignée aux Évêques ne suffisait pas pour leur entretien, on l’augmentait, en y joignant les revenus de quelque abbaye, comme cela s’est pratiqué souvent en France, et comme Nous Nous rappelons que cela s’est fait même sous notre Pontificat. Mais aujourd’hui la subsistance des Évêques dépendra des receveurs et des trésoriers laïques, qui pourront leur refuser leur salaire, s’ils s’opposent aux décrets illégitimes dont je viens de parler : outre cela, chaque Évêque, réduit ainsi à une pension fixe, ne pourra plus, quand la nécessité l’exigera, se procurer un suppléant et un coadjuteur, se trouvant hors d’état de fournir à son entretien d’une manière convenable. Et cependant il arrive souvent dans les diocèses qu’un Évêque, soit par vieillesse, soit par mauvaise santé, ait besoin d’un coadjuteur ; c’est ainsi qu’un Archevêque de Lyon demanda et obtint du Souverain Pontife un suppléant, auquel on assigna une pension sur les revenus de l’archevêché (Benedictus XIV, de Synod. diœc., lib. XIII, cap. XI, n° 12).
Nous venons de voir, avec la plus grande surprise, nos chers Fils et Vénérables Frères, ces renversements des principaux points de la discipline ecclésiastique, ces suppressions, ces divisions, ces érections des sièges épiscopaux, ces élections sacrilèges d’Évêques, et les maux qui doivent en résulter ; mais ne faut-il pas, pour les mêmes raisons, avoir la même idée de la suppression des paroisses ? Vous l’avez déjà remarqué dans votre exposition, mais je ne puis m’empêcher d’y joindre mes propres réflexions. Le droit qu’on attribue aux administrations des départements de fixer elles-mêmes les limites des paroisses comme elles le jugeront à propos, est déjà fort extraordinaire ; mais ce qui m’a causé le plus grand étonnement, c’est le nombre prodigieux de paroisses supprimées ; c’est le décret qui ordonne que, dans les villes ou bourgs de six mille habitants, il n’y aura qu’une seule paroisse. Et comment un curé pourra-t-il jamais suffire à cette foule immense de paroissiens ? Il me paraît à propos de rapporter ici les reproches que fit autrefois à un curé le Cardinal Conrad, envoyé par Grégoire IX pour présider le Synode de Cologne. Ce curé s’opposait fortement à ce qu’on admît dans cette ville des frères prêcheurs. » Quel est, lui demanda le Cardinal, le nombre de vos paroissiens ? Neuf mille, répondit le curé. Et qui êtes-vous, malheureux, reprit le Cardinal, saisi d’étonnement et de colère, qui êtes-vous, pour suffire à l’instruction et à la conduite de tant de milliers d’hommes ? Ne savez-vous pas, aveugle et insensé que vous êtes, qu’au jour du jugement il vous faudra répondre au tribunal de Dieu de tous ceux qui vous sont confiés ? Et vous vous plaindriez d’avoir pour vicaires de fervents religieux, qui porteraient gratuitement une partie du fardeau sous lequel vous êtes écrasé sans le savoir ! Mais parce que vos plaintes me prouvent à quel point vous êtes indigne de gouverner une paroisse, je vous interdis tout bénéfice à charge d’âmes. » (Abraham Bzov. Annal. Eccles. ad ann. 1222, §6, edit. Colon., 1621) Il est vrai que, dans ce passage, il est question de neuf mille paroissiens, tandis que le décret de l’Assemblée n’en donne que six mille à un curé : mais il n’en est pas moins vrai que même six mille paroissiens excèdent de beaucoup les forces d’un seul curé ; et l’inconvénient inévitable de ce nombre excessif, sera de priver plusieurs personnes des secours spirituels, sans leur laisser même la ressource des religieux, qui sont supprimés.
Nous passons maintenant à l’invasion des biens ecclésiastiques, c’est-à-dire à la seconde erreur de Marsile de Padoue et de Jean de Jandun, condamnée par la constitution de Jean XXII (Apud Rainald. ad ann. 1327, n° 28 ac seq.), et longtemps auparavant par le décret du Pape S. Boniface Ier, rapporté par plusieurs écrivains (Apud Coustant., pag. 1050, n° 3). » Il n’est permis à personne d’ignorer, dit le sixième Concile de Tolède (Habit. ann. 638, can. 15, in collect. Labbe, tom. VI, pag. 1497 et 1502), que tout ce qui est consacré à Dieu, homme, animal, champ, en un mot tout ce qui a été une fois dédié au Seigneur, est au nombre des choses saintes, et appartient à l’Église. C’est pourquoi quiconque enlève et ravage, pille et usurpe l’héritage appartenant au Seigneur et à l’Église, doit être regardé comme un sacrilège, tant qu’il n’aura pas expié son crime et satisfait à l’Église. S’il persiste dans son usurpation, qu’il soit excommunié. » Et comme l’observe Loyse, dans ses notes sur ce Concile, Lettre D, » les ouvrages de plusieurs savants écrivains, dont il serait trop long de faire ici mention, prouvent combien il est criminel de dépouiller les Églises des biens que les fidèles leur ont donnés de bonne foi, et de les détourner à un autre usage. J’ajouterai seulement qu’on lit dans les Constitutions orientales, que Nicéphore Phocas enleva les dons faits aux monastères et aux Églises, et porta même une loi qui défendait de leur donner des immeubles, sous prétexte que les Évêques les prodiguaient mal à propos à certains pauvres, tandis que les soldats manquaient du nécessaire. Basile le jeune abolit cette loi impie et téméraire, et lui en substitua une autre digne d’être rapportée ici. Des religieux dont la piété et la vertu sont éprouvées, dit ce prince, et quelques autres saints personnages, m’ont représenté que la loi portée par l’usurpateur Nicéphore, contre les Églises et les maisons religieuses, est la source et la racine de tous les maux qui nous affligent, l’origine des troubles et de la confusion qui règnent dans l’empire, comme étant un outrage sanglant fait, non-seulement aux Églises, aux maisons, religieuses, mais encore à Dieu même. L’expérience s’accorde aussi avec leur sentiment, puisque depuis le moment où cette loi a été exécutée, nous n’avons connu aucun bonheur, et qu’au contraire tous les genres de maux n’ont cessé de fondre sur nous. Persuadé que toute mon autorité vient de Dieu, j’ordonne par la présente bulle d’or qu’on cesse dès aujourd’hui d’observer la loi de Nicéphore, qu’à l’avenir elle soit abolie et regardée comme nulle, et que les anciennes lois touchant les Églises de Dieu et les maisons religieuses soient rétablies dans toute leur vigueur. »
Tel fut aussi le vœu ancien et constant des grands et du peuple de France, vœu exprimé dans les prières qu’ils adressèrent à Charlemagne en 803 (Capitular., tom. I, pag. 405). » Nous supplions tous à genoux Votre Majesté de garantir les Évêques des hostilités auxquelles ils ont été exposés jusqu’ici. Quand nous marchons sur vos pas à l’ennemi, qu’ils restent paisibles dans leurs diocèses… Nous vous déclarons cependant, à vous et à toute la terre, que nous n’entendons pas pour cela les forcer de contribuer de leurs biens aux dépenses de la guerre ; ils seront les maîtres de donner ce qui leur plaira ; notre intention n’est pas de dépouiller les églises, nous voudrions même augmenter leurs richesses, si Dieu nous en donnait le pouvoir, persuadés que ces libéralités seraient votre salut et le nôtre, et nous attireraient la protection du Ciel. Nous savons que les biens de l’Église sont consacrés à Dieu, nous savons que ces biens sont les offrandes des fidèles et la rançon de leurs péchés. Et si quelqu’un est assez téméraire pour enlever aux Églises les dons que les fidèles y ont consacrés à Dieu, il n’y a point de doute qu’il ne commette un sacrilège, et il faut être aveugle pour ne pas le voir. Lorsque quelqu’un d’entre nous donne son bien à l’Église, c’est à Dieu même, c’est à ses saints qu’il l’offre et qu’il le consacre, et non pas à un autre, comme le prouvent les actions et les paroles mêmes du donateur ; car il dresse un état de ce qu’il veut donner, et se présente à l’autel, tenant en main cet écrit, et s’adressant aux prêtres et aux gardiens du lieu : J’offre, dit-il, et je consacre à Dieu tous les biens mentionnés sur ce papier, pour la rémission de mes péchés, de ceux de mes parents et de mes enfants… Celui qui les enlève, après une telle consécration, ne commet-il pas un véritable sacrilège ? S’emparer des biens de son ami, c’est un larcin ; mais dérober ceux de l’Église, c’est incontestablement un sacrilège. Afin donc que tous les domaines ecclésiastiques soient conservés à l’avenir sans aucune fraude, par vous et par nous, par vos successeurs et par les nôtres, nous vous prions de faire insérer notre demande dans les archives de l’Église, et de lui donner une place parmi vos capitulaires. »
» Je vous accorde votre demande, leur répondit l’empereur (Capitular., tom. eod., pag. 407 et 411). Je n’ignore pas que plusieurs empires et plusieurs monarques ont péri pour avoir dépouillé les églises, ravagé, vendu, pillé leurs biens, pour les avoir arrachés aux Évêques et aux Prêtres, et ce qui est pire encore, aux églises elles-mêmes. Et pour que ces biens soient conservés à l’avenir avec plus de respect, nous défendons en notre nom et au nom de nos successeurs, pour toute la durée des siècles, à toute personne, quelle qu’elle soit, d’accepter ou de vendre, sous quelque prétexte que ce puisse être, les biens de l’Église, sans le consentement et la volonté des Évêques dans les diocèses desquels ils sont situés, et, à plus forte raison, d’usurper ces mêmes biens ou de les ravager. S’il arrive que sous notre règne ou sous celui de nos successeurs, quelqu’un se rende coupable de ce crime, qu’il soit soumis aux peines destinées aux sacrilèges, qu’il soit puni légalement par nous, par nos successeurs et par nos juges comme un homicide et un voleur sacrilège, et que nos Évêques lancent contre lui l’anathème. »
Que tous ceux qui participent à cette usurpation se rappellent la vengeance que le Seigneur tira d’Héliodore et de ceux qui lui prêtèrent leurs services pour enlever les trésors du temple ; l’Esprit de Dieu dans ce moment fit éclater sa puissance ; il terrassa et glaça d’épouvante tous les coupables ministres d’Héliodore. Un cheval, couvert de magnifiques harnais, s’offrit à leurs regards effrayés ; le cavalier qui le montait avait un air terrible, et paraissait revêtu d’une armure d’or. Le cheval s’élança sur Héliodore, et lui fracassa le corps à coups de pieds. Deux autres jeunes gens, superbement vêtus, pleins de fierté et d’ardeur, environnèrent ce malheureux, et de chaque côté le flagellèrent sans relâche. Déchiré, sanglant, Héliodore tombe et s’évanouit ; un nuage s’épaissit autour de lui ; alors les jeunes gens l’enlèvent et le jettent dans sa litière. Voilà ce qu’on lit au second livre des Machabées (Cap. III, vers. 24 ad 28), et cependant, il ne s’agissait pas alors des biens destinés aux sacrifices, aux dépenses particulières du temple, mais de l’or qu’on y avait déposé pour plus grande sûreté, et qu’on réservait à l’entretien des veuves, des orphelins et des pauvres, ce qui n’empêcha pas que Dieu n’infligeât à Héliodore et à ses complices ce châtiment terrible, seulement pour avoir violé la majesté et la sainteté du temple, et pour avoir voulu prendre le bien d’autrui. Épouvanté par cet exemple, l’empereur Théodose renonça au dessein qu’il avait de s’emparer du dépôt d’une veuve que l’on conservait dans l’église de Pavie, comme le raconte saint Ambroise (Lib II, de Offic., cap. XXIX, n°s 150 et 151, t. II oper., pag. 106, edit. Maurin.).
Ce qui paraîtra presque incroyable, c’est que, dans le moment où l’on s’empare des biens des églises et des prêtres catholiques, on respecte les possessions que les ministres protestants, ennemis de l’Église, ont autrefois envahies sur elle, et cela sous le prétexte des traités. Sans doute que l’Assemblée nationale regarde les traités faits avec les protestants comme plus sacrés que les canons ecclésiastiques, et que le concordat passé entre le Chef de l’Église et François Ier.
Et il lui a plu de faire cette faveur aux protestants, précisément au moment où elle dépouillait le clergé catholique. Qui ne voit que le principal objet des usurpateurs, dans cette invasion des biens ecclésiastiques, est de profaner les temples, d’avilir les ministres des autels, et de détourner à l’avenir tous les citoyens de l’état ecclésiastique ? Car à peine avaient-ils commencé à porter les mains sur cette proie, que le culte divin a été aboli, les églises fermées, les vases sacrés enlevés, le chant des divins offices interrompu. La France pouvait se glorifier d’avoir vu fleurir dans son sein, dès le sixième siècle, des chapitres de clercs réguliers, comme on peut s’en convaincre par l’autorité de Grégoire de Tours (Hist. Francor., lib. X, §16, pag. 535), par les monuments que dom Mabillon a rassemblés dans un ouvrage intitulé : Recueil choisi des pièces anciennes (pag. 249. Paris. 1722), et le témoignage du troisième Concile d’Orléans, tenu en 538 (canon. 11, pen. Labbe, tom. V, concil., pag. 1277) ; mais elle pleure aujourd’hui l’abolition et la ruine de ces pieux établissements injustement et indignement proscrits par l’Assemblée nationale. La fonction principale des chanoines était de payer chaque jour un tribut commun de louanges à l’Être-Suprême, par le chant des psaumes. Paul le Diacre, dans les Vies qu’il a écrites des Évêques de Metz (tom. XIII, Biblioth. PP. edit. Lugd., p. 321), nous en fournit la preuve. On y lit : que » l’évêque Chrodegand avait non-seulement formé son clergé par l’étude de la loi de Dieu, mais qu’il avait eu le soin de lui faire apprendre le chant romain, et qu’il lui aurait enjoint de se conformer aux usages et à la pratique de l’Église romaine. »
L’empereur Charlemagne ayant adressé au Pape Adrien Ier un ouvrage sur le Culte des images pour le soumettre à son examen, ce Pape profita de cette occasion pour engager l’empereur à établir sans délai l’usage du chant dans plusieurs Églises de France, qui refusaient depuis longtemps de suivre en ce point la pratique de l’Église romaine, afin, disait ce pape, que ces mêmes Églises qui regardent le Saint-Siège comme la règle de leur foi, le regardent encore comme leur modèle dans la manière d’honorer la divinité. La réponse de Charlemagne se trouve en entier dans l’ouvrage de George, sur la Liturgie du Souverain Pontife (Tom. II, dissertat. 1, cap. VII, §6). Le même empereur établit en conséquence une école de chant dans le monastère de Centule, aujourd’hui Saint-Riquier, sur le modèle de celle que S. Grégoire le Grand avait établie à Rome ; il y pourvut à la nourriture de cent jeunes gens, qui, divisés en trois classes, devaient aider les moines dans le chant et la psalmodie (Georg. loco cit., §7). Coloman Sanftl, religieux bibliothécaire du monastère de St-Emmeran à Ratisbonne, vient à l’appui de toutes ces autorités, dans une dissertation qu’il a composée depuis peu de temps, et qu’il Nous a dédiée, sur un très-ancien et très-précieux manuscrit des saints Évangiles, que l’on conserve dans ce monastère (Part. I, Præliminar. §1, part. 3 et 4). » Dans l’origine, dit cet auteur, les Évêques de France et d’Espagne donnèrent tous leurs soins à établir dans chaque province un rit uniforme pour les offices divins. Le recueil des canons faits par les Évêques de ces deux royaumes, contient plusieurs lois sur cette matière. Le règlement le plus célèbre à cet égard est celui du quatrième Concile de Tolède, tenu l’an 531. Les pères de ce Concile, après avoir fait une exposition de la foi catholique, n’eurent rien plus à cœur que d’établir pour les Églises une manière de chanter uniforme. Ce règlement est l’objet du deuxième canon. » Le P. Mabillon, dans ses Recherches sur la liturgie gallicane, parle à peu près de même de l’importance et de l’antiquité de cet usage (In calce suæ gallic. Liturg., §5, n°49, pag. 418, edit. Paris., 1729).
Un rit que l’Église gallicane, dans les siècles même les plus reculés, avait établi et maintenu avec un si grand soin, pour fixer les ecclésiastiques dans l’état de chanoine par des fonctions honorables, un rit qu’elle regardait comme propre à nourrir la piété, à exciter la dévotion des fidèles, et les inviter, par l’attrait du chant et l’éclat des cérémonies, à remplir les devoirs de la religion, et a mériter par là de nouvelles grâces ; l’Assemblée nationale, non sans un grand scandale, vient, par un seul décret, de l’anéantir, de le supprimer et de l’abolir ; et en cela, comme dans tous les autres articles du décret, elle a adopté les principes des hérétiques, et notamment les opinions insensées des Wiclefistes, des Centuriateurs de Magdebourg et de Calvin, qui se sont élevés avec fureur contre l’usage du chant ecclésiastique, et ont osé en nier l’antiquité. La réfutation de ces hérétiques est le sujet d’un grand ouvrage composé par le P. Martin Gerbert, abbé du monastère et de la congrégation de Saint-Blaise, dans la forêt Noire (De cantu et musica sacra., tom. II, lib. IV, cap.II). Nous avons eu occasion de voir plusieurs fois cet auteur estimable à Vienne, en 1782, pendant le séjour que Nous y avons fait pour l’avantage de la religion, et Nous avons reconnu par nous-même combien il est digne de la grande réputation qu’il s’est acquise.
Nous ne pouvons que conseiller aux auteurs de ce décret de lire attentivement les anathèmes prononcés par le Concile d’Arras, en 1025 (Cap. XII, de psallendi officio in collect. Labbe, tom. XI, pag. 1181 et seq.), contre les ennemis du chant ecclésiastique, afin qu’une honte salutaire les fasse rentrer en eux-mêmes. » Qui peut douter, dit le saint Concile, que vous ne soyez possédés de l’esprit immonde, puisque vous rejetez comme une superstition l’usage de la psalmodie établi dans l’Église par l’Esprit-Saint. Ce n’est pas des jeux et des spectacles profanes, mais des Pères de l’Ancien et du Nouveau Testament que le clergé a emprunté le ton et les modulations de cette musique religieuse… Ainsi ceux qui prétendent que le chant des psaumes est étranger au culte divin, doivent être bannis du sein de l’Église…; de tels novateurs sont parfaitement d’accord avec leur chef, c’est-à-dire avec l’esprit de ténèbres, source de toutes les iniquités, et qui cherche à dénaturer, à corrompre par de malignes interprétations le sens des saintes Écritures, quoiqu’il en connaisse le vrai sens. » Enfin, si la gloire de la maison de Dieu, si la majesté du culte est avilie dans le royaume, le nombre des ecclésiastiques diminuera nécessairement, et la France aura le même sort que la Judée, qui, au rapport de saint Augustin (De civit. Dei, lib. XVIII, cap. XLV, n° 1, tom. VI, oper. pag. 527, edit. Maurin.), lorsqu’elle n’eut plus de prophètes, tomba dans l’opprobre et l’avilissement, au moment où elle se croyait à l’époque de sa régénération.
Venons maintenant aux réguliers, dont l’Assemblée nationale s’est réellement appropriée les biens, en déclarant qu’ils sont à la disposition de la nation, expression moins odieuse que celle de propriété, et qui présente, en effet, un sens un peu différent. Par son décret du 13 février, sanctionné six jours après par le roi, elle a supprimé tous les ordres réguliers, et défendu d’en fonder aucun autre à l’avenir. Cependant l’expérience a fait voir combien ils étaient utiles à l’Église ; le Concile de Trente leur a rendu ce témoignage ; il a déclaré (Sess. 25, de regular., cap. I), » qu’il n’ignorait pas combien de gloire et d’avantages procuraient à l’Église de Dieu les monastères saintement institués et sagement gouvernés. »
Tous les Pères de l’Église ont comblé d’éloges les ordres réguliers, et S. Chrysostôme, entre autres, a composé trois livres entiers contre leurs détracteurs (Tom. I, oper. edit Maurin. a pag. 44 ad 118, et opuscul. de comparation. regis et monachi, tom. eod. a pag. 116 ad 121). S. Grégoire le Grand, après avoir averti Marinien, Archevêque de Ravenne, de n’exercer aucune vexation contre les monastères, mais, au contraire, de les protéger et de tâcher d’y réunir un grand nombre de religieux (Epist. 29, litt. A, lib. VI, t. II, oper. edit. Maurin.), assembla un Concile d’Évêques et de Prêtres, où il porta un décret qui défend à tout Évêque et à tout séculier de causer quelque dommage, par surprise ou autrement, dans quelque circonstance que ce soit, aux revenus, biens, chartes, maisons des religieux, et d’y faire aucune incursion (In appendic. espistolar. S. Gregorii magni cit., tom. II, pag. 1294, n° 7). Au XIIIe siècle, Guillaume de Saint-Amour se répandit en invectives contre eux, dans son livre intitulé : Des dangers des derniers temps, où il détourne les hommes de se convertir et d’entrer en religion. Mais ce livre fut condamné par le Pape Alexandre IV, comme criminel, exécrable et impie (Constit. 32, int. Illas ejusde. Pont. in bullar. Rom., tom. III, p. 378, edit. Rom., 1740).
Deux docteurs de l’Église, S. Thomas d’Aquin (Tom. XXV, oper. edit. Paris., 1660, pag. 533 ad 666) et S. Bonaventure (Libell. Apologetic., tom. VII, oper. edit. Lugdun., 1668, pag. 346 ad 385), ont aussi repoussé les calomnies de Guillaume ; et Luther, ayant adopté la même doctrine, a été également condamné par le Pape Léon X (Bulla in collect. concilior. Labbe, tom. XIX, pag. 153). Le Concile de Rouen, tenu en 1581 (In ead. collect. Labbe, cap. de curator. offic., n° 41, tom. XXI, pag. 651), recommande aux Évêques de protéger, de chérir les réguliers, qui partagent avec eux les fatigues du ministère, de les nourrir comme leurs coadjuteurs, et de repousser, comme si elles leur étaient personnelles, toutes les insultes faites aux religieux. L’histoire a consacré le souvenir des pieux projets de S. Louis, roi de France, qui avait résolu de faire élever, dans un monastère, deux fils qu’il avait eus pendant le cours de son expédition d’Orient, quand ils auraient atteint l’âge de raison ; l’un devait être confié aux Dominicains, l’autre aux Frères Mineurs, pour qu’ils fussent formés, dans cette sainte école, à l’amour de la religion et des lettres ; et leur père désirait de tout son cœur que ces jeunes princes, imbus des plus salutaires préceptes, et inspirés de l’esprit de Dieu, se consacrassent tout entiers à la piété dans ces mêmes monastères qui auraient servi à leur éducation (Vita S. Ludovici, cap. XIV, inter. Francor. script. collect. a Duchesne, tom. V, pag. 448 in fin.). Dans ces derniers temps, les auteurs de l’ouvrage intitulé Nouveau traité de diplomatique (Où l’on examine les fondements de cet art, t. V, p. 379, in fin. et 380, édit. Paris., 1762), réfutant les ennemis des privilèges accordés aux religieux, se sont exprimés avec beaucoup d’énergie : » Quelle attention, disent-ils, peuvent donc mériter les déclamations de l’historien du droit public ecclésiastique français, contre les privilèges accordés aux monastères ; privilèges, dit-il, et exemptions qui n’ont pu être accordés sans renverser la hiérarchie, sans violer les droits de l’épiscopat, et qui sont de vrais abus, et en ont produit de fort considérables ? QUELLE TÉMÉRITÉ de s’élever ainsi contre une discipline si ancienne, si autorisée dans l’Église et dans l’État ! »
Il est bien vrai que plusieurs ordres religieux se sont relâchés de leur ferveur primitive, que la sévérité de l’ancienne discipline s’y est considérablement affaiblie, et personne ne doit en être surpris. Mais faut-il pour cela les détruire ? Écoutons ce que répondit au Concile de Bâle Jean de Polemar, aux objections de Pierre Rayne, contre les réguliers. Il convint d’abord » qu’il s’était glissé, parmi les réguliers, quelques abus qui exigeaient une réforme. Mais en admettant qu’on pouvait leur faire ce reproche, comme à tous les autres états, il ne s’étendit pas moins sur les éloges qu’ils méritaient, par les lumières que leur doctrine et leur prédication répandaient dans l’Église. Un homme raisonnable, dit-il, se trouvant dans un lieu obscur, éteint-il la lampe qui l’éclaire, parce qu’elle ne jette pas un assez grand éclat ? Ne prend-il pas soin plutôt de la nettoyer et de la mettre en état ? Ne vaut-il pas mieux, en effet, être un peu moins bien éclairé, que de rester absolument sans lumière ? » (In collect. Labbe, tom. XVII, pag. 1231) Cette pensée est la même que celle de saint Augustin, qui avait dit, longtemps auparavant, » Faut-il donc abandonner l’étude de la médecine, parce qu’il y a des maladies incurables ? » (Epist. 93, n° 3, tom. II, oper. pag. 231, edit. Maurin).
Ainsi, l’Assemblée nationale, empressée à favoriser les faux systèmes des hérétiques, en abolissant les ordres religieux, condamne la profession publique des conseils de l’Évangile ; elle blâme un genre de vie toujours approuvé dans l’Église, comme très-conforme à la doctrine des apôtres : elle insulte les saints fondateurs de ces ordres, à qui la religion a élevé des autels, et qui n’ont établi ces sociétés que par une inspiration divine. Mais l’Assemblée nationale, va plus loin encore. Dans son décret du 13 février 1790, elle déclare qu’elle ne reconnaît point les vœux solennels des religieux, et par conséquent, que les ordres et congrégations régulières où l’on fait ces vœux, sont et demeurent supprimés en France, et qu’à l’avenir on ne pourra jamais en fonder de semblables. N’est-ce pas là une atteinte portée à l’autorité du Souverain Pontife, qui seul a le droit de statuer sur les vœux solennels et perpétuels ? » Les grands vœux, dit S. Thomas d’Aquin, c’est-à-dire les vœux de continence, etc. sont réservés au Souverain Pontife. Ces vœux sont des engagements solennels que nous contractons avec Dieu pour notre propre avantage » (I, 2, quest. 88, art. 12, in fin.). C’est pour cela que le prophète a dit dans le psaume 75, v. 12 : » Engagez-vous par des vœux avec le Seigneur votre Dieu, et gardez-vous ensuite d’y être infidèles. » C’est pour cela encore qu’on lit dans l’Ecclésiaste (cap. V, vers. 3) : » Si vous avez fait un vœu à Dieu, ne tardez pas à l’accomplir ; une promesse vaine et sans effet est un crime à ses yeux ; soyez donc fidèle à tenir tout ce que vous lui avez promis. »
Aussi, lors même que le Souverain Pontife croit, pour des raisons particulières, devoir accorder dispense des vœux solennels, ce n’est pas en vertu d’un pouvoir personnel et arbitraire qu’il agit ; il ne fait que manifester la volonté de Dieu dont il est l’organe. Il ne faut pas être étonné que Luther ait enseigné qu’on n’était pas tenu d’accomplir ses vœux, puisque lui-même fut un apostat, un déserteur de son ordre. Les membres de l’Assemblée nationale, qui se piquent d’être sages et prudents, voulant se dérober aux murmures et aux reproches que la vue de tant de religieux dispersés allait exciter tout contre eux, ont jugé à propos d’ôter aux religieux leur habit, pour qu’il ne restât aucune trace de l’état auquel on les avait arrachés, et pour effacer même jusqu’au souvenir des ordres monastiques. On a donc détruit les religieux, d’abord pour s’emparer de leurs biens, ensuite pour anéantir la race de ces hommes qui pouvaient éclairer le peuple, et s’opposer à la corruption des mœurs. Ce stratagème perfide et coupable est peint avec énergie, et réprouvé par le Concile de Sens : » Ils accordent, dit-il, aux moines et à tous ceux qui sont liés par des vœux, la liberté de suivre leurs passions ; ils leur offrent la liberté de quitter leur habit, de rentrer dans le monde ; ils les invitent à l’apostasie, et leur apprennent à braver les décrets des Pontifes et les canons des Conciles. » (In collect. Labbe, tom. XIX, pag. 1157 et 1158.)
Ajoutons à ce que je viens de dire sur les vœux des réguliers, l’odieux décret porté contre les vierges saintes, et qui les chasse de leur asile, à l’exemple de Luther : car on vit aussi cet hérésiarque, suivant le langage du Pape Adrien VI, » souiller ces vases consacrés au Seigneur, arracher des monastères les vierges vouées à Dieu, et les rendre au monde profane, ou plutôt à Satan qu’elles avaient abjuré. » (Hadrianus VI. In brevi ad Frideric. Saxoniæ duc. advers. Luther. in collect. Labbe, tom. XIX, pag. 10, lib. IV.) Cependant les religieuses, cette portion si distinguée du troupeau des fidèles catholiques, ont souvent, par leurs prières, détourné de dessus les villes les plus grands fléaux : » S’il n’y avait pas eu de religieuses à Rome, dit saint Grégoire le Grand, aucun de nous, depuis tant d’années, n’eût échappé au glaive des Lombards. » (Epist. 26, lib. VII, pag. 872, edit. Maurin.) Benoît XIV rend le même témoignage aux religieuses de Bologne : » Cette ville accablée de tant de calamités depuis plusieurs années, ne subsisterait plus aujourd’hui si les prières de nos religieuses n’eussent apaisé la colère du Ciel. » (Institut. Ecclesiastic. 29, pag. 142, edit. Rom., 1747) Notre cœur a été vivement touché des persécutions qu’éprouvent les religieuses en France ; la plupart Nous ont écrit des différentes provinces de ce royaume pour Nous témoigner à quel point elles étaient affligées de voir qu’on les empêchait d’observer leur règle et d’être fidèles à leurs vœux ; elles Nous ont protesté qu’elles étaient déterminées à tout souffrir, plutôt que de manquer à leurs engagements. Nous devons, nos chers Fils et Vénérables Frères, rendre auprès de vous témoignage à leur constance et à leur courage ; Nous vous prions de les soutenir encore par vos conseils et vos exhortations, et de leur donner tous les secours qui seront en votre pouvoir.
Nous pourrions faire un grand nombre d’autres observations sur cette nouvelle constitution du clergé, qui, depuis le commencement jusqu’à la fin, n’offre presque rien qui ne soit dangereux et répréhensible ; qui, dans toutes ses parties, dictée par le même esprit et par les mêmes principes, présente à peine un article sain et tout à fait exempt d’erreur. Mais après en avoir relevé les dispositions, les plus choquantes, lorsque les papiers publics Nous ont appris que l’Évêque d’Autun contre notre attente s’était engagé par serment à observer une aussi blâmable constitution, Nous avons été accablé d’une si violente douleur que la plume Nous est tombée des mains : Nous n’avions plus de forces pour continuer notre travail, et jour et nuit nos yeux étaient baignés de larmes, en voyant un Évêque, un seul Évêque se séparer de ses collègues, et prendre le Ciel à témoin de ses erreurs. Il est vrai qu’il a prétendu se justifier sur un article, qui concerne la nouvelle distribution des diocèses ; il s’est servi d’une comparaison frivole, qui peut en imposer aux simples et faire illusion aux ignorants. C’est, dit-il, comme si tout le peuple d’un diocèse, par l’effet de quelque besoin pressant, recevait ordre de la puissance civile de passer dans un autre diocèse. Mais il n’y a aucune parité entre ces deux exemples. En effet, lorsque le peuple d’un diocèse l’abandonne pour passer dans un autre, l’Évêque du diocèse où il se transporte exerce sur ces nouveaux habitants, dans l’étendue de son ressort, sa juridiction propre et ordinaire, juridiction qu’il ne tient pas de la puissance civile, mais qui lui appartient de droit en vertu de son titre ; car tous ceux qui habitent un diocèse sont soumis de droit au gouvernement de l’Évêque de ce diocèse, à raison du séjour qu’ils y font et du domicile qu’ils y ont établi. Que s’il arrive que l’Évêque du diocèse abandonné par le peuple se trouve absolument seul, ce pasteur sans troupeau n’en sera pas moins Évêque, son église n’en sera pas moins une cathédrale ; l’Évêque et son église conserveront tous leurs droits : c’est ce qui a lieu pour les églises qui sont sous la domination des Turcs et des infidèles, et dont on confère souvent encore le titre à des Évêques. Mais quand les bornes des diocèses sont entièrement bouleversées et confondues, quand des diocèses en totalité ou en partie sont enlevés à leur Évêque et donnés à un autre, alors l’Évêque que l’on dépouille de son diocèse en totalité ou en partie, ne peut, sans y être autorisé par l’Église, abandonner le troupeau qui lui a été confié ; et l’autre Évêque à qui l’on donne irrégulièrement un nouveau diocèse, ne peut exercer aucune juridiction sur un territoire étranger, ni conduire les brebis d’un autre pasteur ; car la mission canonique et la juridiction de chaque Évêque est renfermée dans certaines bornes, et jamais l’autorité civile ne pourra ni les étendre ni les resserrer.
On ne pouvait donc rien imaginer de plus absurde que cette comparaison de l’émigration du peuple d’un diocèse dans un autre, avec les changements qu’on veut aujourd’hui introduire dans les diocèses et dans leurs limites ; car dans le premier cas l’Évêque ne cesse point d’exercer dans son diocèse la juridiction qui lui est propre, au lieu que dans le second l’Évêque étend sa juridiction sur un diocèse étranger dans lequel il ne peut exercer aucune fonction. Nous ne voyons donc rien dans la doctrine de l’Église catholique qui puisse excuser en aucune manière le serment impie prêté par l’Évêque d’Autun.
Les premières qualités d’un serment sont d’être vrai et juste : mais d’après les principes que Nous avons établis, où est la vérité, où est la justice dans un serment qui ne renferme rien que de faux et d’illégitime ? L’Évêque d’Autun ne s’est pas même laissé à lui-même l’excuse de la légèreté et de la précipitation. Son serment a été le fruit de la réflexion et d’un dessein prémédité, puisqu’il a cherché des sophismes pour le justifier. N’avait-il pas d’ailleurs sous les yeux l’exemple de ses collègues qui combattaient cette constitution avec autant de piété que de savoir ; et la mémoire de sa consécration, encore récente, ne devait-elle pas retracer à son esprit un serment bien différent, qu’il avait prêté dans cette cérémonie. Il faut donc dire qu’il s’est souillé d’un parjure aussi volontaire que sacrilège, en prêtant un serment contraire aux dogmes de l’Église et à ses droits les plus sacrés.
Il ne sera pas hors de propos de rappeler ici ce qui s’est passé en Angleterre sous le règne de Henri II. Ce prince avait fait une constitution du clergé à peu près semblable à celle de l’Assemblée nationale, mais qui contenait un moindre nombre d’articles. Il y abolissait les libertés de l’Église anglicane, et s’attribuait à lui-même les droits et l’autorité des supérieurs ecclésiastiques. Il exigea des Évêques un serment par lequel ils s’engageraient d’observer cette constitution, qui, selon lui, n’était que les anciennes coutumes du royaume. Les Évêques ne refusaient pas le serment, mais ils voulaient y joindre cette clause : sauf les droits de leur ordre, clause qui déplaisait extrêmement au roi ; il y avait, disait-il, un venin caché sous cette restriction captieuse ; il voulait les forcer à jurer purement et simplement qu’ils se conformeraient aux anciennes coutumes royales. Les Évêques étaient accablés et consternés de cet ordre tyrannique. Mais Thomas, Archevêque de Cantorbéry, depuis honoré de la palme du martyre, les encourageait à la résistance ; il animait leur vertu chancelante, et les exhortait à ne pas trahir les sentiments et les devoirs d’un Évêque. » Cependant les persécutions et les violences devenant de jour en jour plus insupportables, quelques Évêques suppliaient l’Archevêque de Cantorbéry de relâcher quelque chose de son inflexible fermeté, d’épargner à son clergé les maux de l’exil, et à lui-même les horreurs de la prison. Alors cet homme jusqu’à ce jour invincible, que ni les caresses, ni les menaces n’avaient jamais pu ébranler, moins sensible aux dangers qui le menaçaient qu’au sort de son clergé, se laissa arracher du sein de la vérité et des bras de l’Église sa Mère. » Il jura, et son exemple fut suivi des autres Évêques ; mais il ne tarda pas à reconnaître son erreur : le plus vif repentir déchira son âme. » J’ai horreur de moi-même, je déteste ma faiblesse, s’écriait-il en gémissant, je suis indigne d’exercer l’auguste ministère du sacerdoce sur l’autel de Jésus-Christ, après avoir lâchement vendu son Église ; je resterai donc enseveli dans le silence et dans la douleur, attendant que la grâce du Ciel vienne me consoler, et que le Vicaire de Dieu sur la terre m’accorde mon pardon. Hélas ! j’ai donc asservi et déshonoré par mon crime cette Église anglicane que mes prédécesseurs avaient gouvernée avec tant de prudence et de gloire au milieu des dangers du siècle, cette Église pour laquelle ils avaient livré tant de combats, théâtre de tant de victoires et de triomphes qu’ils avaient remportés sur les ennemis ! Autrefois reine et maîtresse, elle est aujourd’hui, par ma faute, réduite en esclavage ! Que n’ai-je disparu de dessus la face de la terre avant d’avoir imprimé à mon nom une pareille tache ! »
Thomas se hâta d’écrire au Pape ; il lui découvrit sa plaie, et en demanda le remède. Le Pontife, reconnaissant que Thomas avait été entraîné dans ce serment, non par sa propre volonté, mais par une indiscrète compassion, fut touché de l’expression de son repentir, et lui accorda l’absolution. Thomas reçut avec transport la lettre du Pape, comme si elle lui eût été envoyée du Ciel même. Dès lors, rien ne fut plus capable d’arrêter son zèle ; il ne cessait de faire au roi des remontrances, et, mêlant à propos la force à la douceur, il ne négligea rien pour parer les coups que ce prince se disposait à porter à l’Église. Le roi n’eut pas plutôt appris que Thomas s’était rétracté, qu’il écrivit au Pape pour lui demander deux choses : la première, d’approuver ce qu’il appelait les anciennes coutumes royales ; la seconde, de transporter le privilège de légat apostolique de l’Église de Cantorbéry à celle d’York. Le Pape rejeta la première demande, comme on peut le voir dans sa lettre à saint Thomas. Il accorda la seconde, parce qu’il le pouvait sans blesser l’honneur et les droits du clergé ; mais il écrivit à l’Évêque d’York pour lui défendre d’exercer aucun acte de juridiction dans la province de Cantorbéry, et d’y faire porter la croix devant lui. Thomas s’enfuit d’abord en France, ensuite à Rome, où il reçut l’accueil le plus favorable du Souverain Pontife : il lui montra l’écrit contenant, en seize articles, les anciennes coutumes royales. Elles furent examinées et rejetées. Enfin, l’intrépide Thomas, de retour en Angleterre, s’avance d’un pas ferme vers le supplice qu’on lui réservait, plein du précepte de l’Évangile qui dit : » Que celui qui veut venir après moi se renonce lui-même, qu’il porte sa croix et me suive. » Il ouvrit aux bourreaux les portes de son église, et, se recommandant à Dieu, à la bienheureuse Vierge Marie, et aux saints patrons de sa cathédrale, il reçut plusieurs blessures à la tête et expira victime de son zèle pour la gloire de Dieu et martyr des libertés de l’Église anglicane. Ce récit est extrait des Annales de l’Église d’Angleterre, par Arfold. (Tom. IV, ab ann. 1054 ad 1171.)
Il n’y a personne qui ne soit frappé de la parfaite ressemblance qui se trouve entre la conduite de l’Assemblée nationale et celle de Henri II. Comme lui, l’Assemblée nationale a porté des décrets par lesquels elle s’attribue la puissance spirituelle ; comme lui, elle a forcé tout le monde de jurer, surtout les Évêques et les autres ecclésiastiques, et c’est à elle maintenant que les Évêques sont obligés de prêter le serment qu’ils prêtaient autrefois au Pape. Elle s’est emparée des biens de l’Église, à l’exemple de Henri II, à qui S. Thomas les redemanda avec instance. Le Roi Très-Chrétien a été contraint d’apposer sa sanction à ses décrets. Enfin les Évêques de France, comme ceux d’Angleterre, ont proposé à cette Assemblée une formule de serment dans laquelle ils distinguaient les droits de la puissance temporelle d’avec ceux de l’autorité spirituelle, protestant qu’ils se soumettaient à ce qui était purement civil, et ne rejetaient que les objets pour lesquels l’Assemblée était incompétente, semblables à ces généreux soldats chrétiens qui servaient sous Julien l’Apostat, et dont S. Augustin fait l’éloge en ces termes (Enarr., in psalm. 124, n° 7, in fin., t. IV oper., pag. 1416, edit. Maurin.) : » Julien fut empereur infidèle, un insigne apostat, un détestable idolâtre ; cependant il avait dans son armée des soldats chrétiens qui lui obéissaient fidèlement ; mais quand il était question des intérêts de Jésus-Christ, ils ne reconnaissaient que les ordres du Roi du ciel : si on leur commandait d’adorer des idoles, de leur offrir de l’encens, ils préféraient Dieu à l’empereur ; mais quand il leur disait : Rangez-vous en bataille, marchez contre cette nation, ils obéissaient sur-le-champ, car ils savaient distinguer le Maître éternel du maître temporel. » Cependant l’Assemblée nationale a rejeté ces restrictions, comme Henri II refusa d’admettre la clause, sauf les droits de notre ordre. Les nouveaux règlements prescrits par l’Assemblée nationale pour la ruine du clergé, s’accordent de point en point avec ceux que Henri II a adoptés.
Cependant elle ne s’est pas bornée à imiter Henri II, elle s’est aussi piquée de marcher sur les traces de Henri VIII ; car ce prince ayant usurpé la suprématie de l’Église anglicane, en confia l’exercice au Zuinglien Cromwel, et l’établit son vicaire général dans tout ce qui concernait le spirituel ; il le chargea de la visite de tous les monastères du royaume, et ce Cromwel, à son tour, se reposa de ce soin sur son ami Cranmer, imbu des mêmes principes que lui. Il n’oublia rien pour affermir dans l’Angleterre la suprématie ecclésiastique du roi, et pour engager la nation à reconnaître dans ce prince toute la puissance que Dieu n’a donnée qu’à son Église. Les visites des monastères consistaient à les détruire, à les piller, à faire une dilapidation sacrilège des biens ecclésiastiques, et par là les visiteurs trouvaient le moyen de satisfaire à la fois leur avarice et leur haine contre le Pape. Autrefois Henri VIII affecta de soutenir que la formule de serment proposée aux Évêques ne renfermait que la promesse d’une obéissance temporelle et d’une fidélité purement civile, tandis qu’en effet elle abolissait toute l’autorité du Saint-Siège ; de même l’Assemblée qui domine en France a donné à ses décrets le titre spécieux de Constitution civile du clergé, quoiqu’ils renversent réellement tonte la puissance ecclésiastique, et bornent la communication des Évêques avec Nous à la simple formalité de Nous donner avis de ce qui a été fait et exécuté sans notre aveu. Qui pourrait ne pas voir que l’Assemblée a réellement eu en vue les décrets des deux rois d’Angleterre, Henri II et Henri VIII, et qu’elle s’est proposé pour but de les faire passer dans sa Constitution : autrement aurait-elle pu parvenir à une imitation aussi parfaite des principes et de la conduite de ces deux princes ? S’il s’y trouve quelque différence, c’est que les nouvelles entreprises sont encore plus pernicieuses que les anciennes.
Après avoir comparé les deux Henri avec l’Assemblée nationale, mettons maintenant l’Évêque d’Autun en parallèle avec ses collègues, et, pour ne pas trop Nous appesantir sur les détails, envisageons seulement la constitution même qu’il a juré d’observer sans restriction : cela suffira pour faire sentir combien sa croyance diffère de celle des autres Évêques. Ceux-ci, marchant sans reproche dans la loi du Seigneur, ont conservé le dogme et la doctrine de leurs prédécesseurs avec un courage héroïque ; ils sont restés fermement attachés à la Chaire de S. Pierre ; exerçant et soutenant leurs droits avec intrépidité, s’opposant de tout leur pouvoir aux innovations, ils ont attendu constamment notre réponse, qui devait régler leur conduite. Comme ils ont tous la même foi, la même tradition, la même discipline, ils l’ont tous confessée de la même manière, et leur langage a été uniforme. Nous restons immobile d’étonnement quand nous voyons l’Évêque d’Autun insensible aux exemples, aux raisons de tous les Évêques. Bossuet, Évêque de Meaux, prélat très-célèbre parmi vous, et auteur non suspect (Histoire des variations des Églises protestantes, lib. VII, n° 114, tom. III oper. edit. Paris. 1747), avait fait avant moi une semblable comparaison entre S. Thomas de Cantorbéry et Thomas Cranmer. Nous la transcrivons ici, pour que ceux qui la liront puissent juger à quel point elle ressemble au parallèle que Nous établissons entre l’Évêque d’Autun et ses collègues : » S. Thomas de Cantorbéry résista aux rois iniques ; Thomas Cranmer leur prostitua sa conscience et flatta leur passion. L’un banni, privé de ses biens, persécuté dans les siens et dans sa propre personne, et affligé en toutes manières, acheta la liberté glorieuse de dire la vérité comme il la croyait, par un mépris courageux de la vie et de toutes ses commodités ; l’autre, pour plaire à son prince, a passé sa vie dans une honteuse dissimulation, et n’a cessé d’agir en tout contre sa créance. L’un combattit jusqu’au sang pour les moindres droits de l’Église, et, en soutenant ses prérogatives, tant celles que Jésus-Christ lui avait acquises par son sang que celles que les rois pieux lui avaient données, il défendit jusqu’au dehors de cette sainte cité ; l’autre en livra aux rois de la terre le dépôt le plus intime, la parole, le culte, les sacrements, les clefs, l’autorité, les censures, la foi même ; tout enfin est mis sous le joug, et toute la puissance ecclésiastique étant réunie au trône royal, l’Église n’a plus de force qu’autant qu’il plaît au siècle. L’un enfin, toujours intrépide et toujours pieux pendant sa vie, le fut encore plus à sa dernière heure ; l’autre, toujours faible et toujours tremblant, l’a été plus que jamais dans les approches de la mort, et, à l’âge de soixante-deux ans, il a sacrifié à un misérable reste de vie sa foi et sa conscience. Aussi n’a-t-il laissé qu’un nom odieux parmi les hommes, et pour l’excuser dans son parti même, on n’a que des détours ingénieux que les faits démentent. Mais la gloire de S. Thomas de Cantorbéry vivra autant que l’Église, et ses vertus, que la France et l’Angleterre ont révérées comme à l’envi, ne seront jamais oubliées. » Telles sont les paroles de Bossuet.
Ce qui est beaucoup plus étonnant encore, c’est que l’Évêque d’Autun n’ait point été touché de la déclaration faite par le Chapitre de son église cathédrale, le 1er décembre 1790 : comment n’a-t-il pas rougi d’avoir encouru le blâme, et de recevoir des leçons de ce même clergé auquel il devait l’exemple, et qu’il était fait pour instruire et pour éclairer lui-même ? (*) Dans cette déclaration, le clergé d’Autun, appuyé sur les vrais principes de l’Église, s’élève contre les erreurs renfermées dans la constitution du clergé, et s’exprime en ces termes : » Le chapitre d’Autun déclare, 1° adhérer formellement à l’exposition des principes sur la constitution du clergé, donnée par MM. les Évêques députés à l’Assemblée nationale, le 30 octobre dernier ; déclare 2° que, sans manquer aux devoirs de sa conscience, il ne peut participer ni directement ni indirectement à l’exécution du plan de la nouvelle constitution du clergé, et notamment en ce qui concerne la suppression des églises cathédrales ; et qu’en conséquence, il continuera ses fonctions sacrées et canoniales ainsi que l’acquittement des nombreuses fondations dont son Église est chargée, jusqu’à ce qu’il soit réduit à l’impossibilité absolue de les remplir ; déclare 3° qu’en qualité de conservateur-né des biens et des droits de l’évêché, et en vertu de la juridiction spirituelle qui est dévolue aux églises cathédrales pendant la vacance du siège épiscopal, il ne peut consentir à une nouvelle circonscription qui serait faite du diocèse d’Autun par la seule autorité temporelle. »
(*) : Les curés du diocèse d’Autun n’ont pas déployé moins de zèle et d’énergie que le Chapitre, comme on peut le voir par leur réponse à la lettre de leur Évêque, insérée dans le Journ. Ecclés. de M. l’abbé Barruel. Mars 1791.(Note de l’éditeur – c’est-à-dire de l’éditeur de l’ouvrage » Recueil des allocutions consistoriales, encycliques et autres lettres apostoliques des souverains pontifes Clément XII, Benoît XIV, Pie VI, Pie VII, Léon XII, Grégoire XVI et Pie IX, citées dans l’encyclique et le Syllabus du 8 décembre 1864 « , deuxième édition, Paris, Librairie Adrien Le Clere et Cie , rue Cassette, 29, près Saint-Sulpice, MDCCCLXV, livre d’où cette traduction est numérisée.)
Nous ne voulons pas, au reste, laisser ignorer à l’Évêque d’Autun et à ceux qui, dans l’intervalle, auraient pu se parjurer à son exemple, ce que l’Église prononça sur les Évêques qui assistèrent au Concile de Rimini, et qui, cédant à la crainte des menaces de l’empereur Constance, signèrent la formule équivoque et captieuse imaginée par les Ariens pour les tromper. Le Pape Libère les avertit que s’ils persistaient dans cette erreur, il déploierait pour les punir toute l’autorité que lui donnait l’Église catholique. » (Epist. Liber. ad cathol. Episc. in Fragment. ex oper. historic. S. Hilar. Fragment. 12, pag. 1358, edit. Maurin.) Saint Hilaire de Poitiers fit chasser de l’église d’Arles l’Évêque Saturnin, qui soutenait avec opiniâtreté la doctrine des Évêques ariens (Sulpic. Sever. Histor. sac. lib. II, cap. XLV, tom. II, pag. 245, edit. Veron.). Enfin, le jugement de Libère fut confirmé par saint Damase, dans une lettre synodale publiée dans un Concile de quatre-vingt-dix Évêques, afin que les Évêques mêmes de l’Orient pussent rétracter publiquement leurs erreurs, s’ils voulaient être catholiques et passer pour tels. » Nous croyons, dit saint Damase, que ceux à qui leur faiblesse ne permet pas de faire une pareille démarche, doivent être au plus tôt séparés de notre communion et privés de la dignité épiscopale, afin que les peuples de leur diocèse puissent respirer à l’abri de l’erreur. » (Epist. ad Epis. Illyricos, epist. III, n° 2, apud Coustan., pag. 482 et 486.) On ne peut nier que l’Évêque d’Autun et ses imitateurs ne se soient mis dans le même cas que les Évêques condamnés par Libère et Damase. C’est pourquoi, s’ils ne rétractent pas leur serment, ils savent à quoi ils doivent s’attendre.
Les idées et les sentiments que Nous venons de développer, ce n’est pas notre esprit particulier qui Nous les a suggérés ; Nous les avons puisés dans les sources les plus pures de la science divine. C’est à vous maintenant que Nous Nous adressons, nos très-chers Frères, objet de nos plus tendres sollicitudes, vous qui faites notre joie et notre couronne ; vous n’avez pas sans doute besoin d’être animés par des exhortations, puisque Nous Nous glorifions de la foi courageuse que vous avez fait éclater dans les tribulations, dans les disgrâces et les persécutions ; puisque vos savants écrits ont prouvé que votre refus d’adhérer aux décrets de l’Assemblée était fondé sur les plus fortes raisons. Cependant dans ce siècle malheureux, ceux même qui paraissent le plus affermis dans les sentiers du Seigneur doivent prendre toutes les précautions possibles pour se soutenir. Aussi, en vertu des fonctions pastorales dont Nous sommes chargé malgré notre indignité, Nous vous exhortons à faire tous vos efforts pour conserver parmi vous la concorde, afin qu’étant tous unis de cœur, de principes et de conduite, vous puissiez repousser avec un même esprit les embûches de ces nouveaux législateurs, et, avec le secours de Dieu, défendre la religion catholique contre leurs entreprises. Rien ne pourrait contribuer davantage au succès de vos ennemis que la division qui se mettrait parmi vous : un parfait accord, une union inaltérable de pensées et de volonté est le plus ferme rempart et l’arme la plus redoutable que vous puissiez opposer à leurs efforts et à leurs complots. Nous empruntons donc ici les expressions dont se servait mon prédécesseur saint Pie V, pour animer le Chapitre et les chanoines de Besançon (Epist. 6, lib. III, edit. Antuerp., 1640) réduits à la même situation que vous : Que votre âme soit inébranlable et invincible : que ni les dangers ni les menaces n’affaiblissent vos résolutions. Rappelez-vous l’intrépidité de David en présence du géant et le courage des Machabées devant Antiochus ; retracez-vous Basile résistant à Valens, Hilaire à Constance ; Yves de Chartres au roi Philippe. Déjà, pour ce qui Nous concerne, Nous avons ordonné des prières publiques ; Nous avons exhorté le roi à refuser sa sanction ; Nous avons averti de leur devoir les deux Archevêques qui étaient de son conseil ; et, pour calmer et adoucir autant qu’il était en notre pouvoir les dispositions violentes dans lesquelles était ce qu’on nomme parmi vous le tiers état, nous avons cessé d’exiger le payement des droits que la France devait à la chambre apostolique, d’après les anciennes conventions qu’un usage invariable avait confirmées. Ce sacrifice de notre part n’a pas été senti comme il devait l’être ; et Nous avons eu la douleur de voir quelques membres de l’Assemblée nationale allumer, répandre et entretenir dans Avignon le feu d’une révolte contre laquelle Nous ne cesserons de réclamer et d’invoquer les droits du Saint-Siège. Nous n’avons point encore jusqu’ici lancé les foudres de l’Église contre les auteurs de cette malheureuse constitution du clergé ; Nous avons opposé à tous les outrages la douceur et la patience ; Nous avons fait tout ce qui dépendait de Nous pour éviter le schisme et ramener la paix au milieu de votre nation ; et même encore, attaché aux conseils de la charité paternelle qui sont tracés à la fin de votre exposition, Nous vous conjurons de Nous faire connaître comment Nous pourrions parvenir à concilier les esprits. La grande distance des lieux ne Nous permet pas de juger quels sont les moyens les plus convenables ; mais vous, placés au centre des événements, vous trouverez peut-être quelque expédient qui ne blesse point le dogme catholique et la discipline universelle de l’Église. Nous vous prions de Nous le communiquer, pour que nous puissions l’examiner avec soin et le soumettre à une mûre délibération.
Il Nous reste à supplier le Seigneur de conserver longtemps à son Église des pasteurs aussi sages et aussi vigilants ; Nous accompagnons ce vœu de notre Bénédiction apostolique, que Nous vous donnons, nos chers Fils et Vénérables Frères, du fond du cœur et dans l’effusion de notre tendresse paternelle.
Donné à Rome, à Saint-Pierre, le 10 mars de l’année 1791, la dix-septième de notre Pontificat.
Signé : PIE.